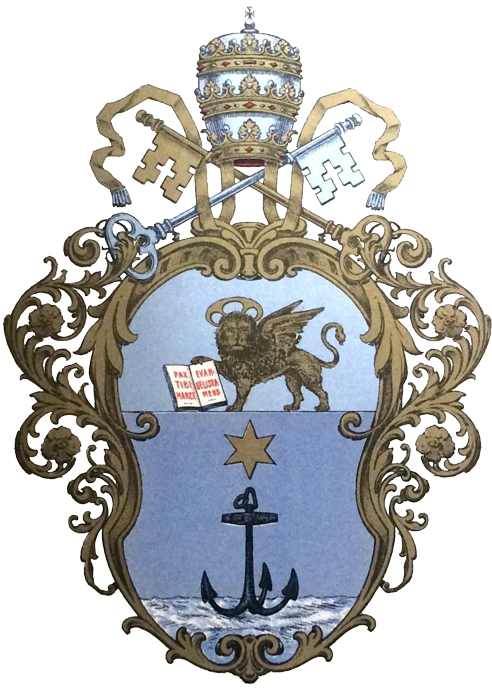LETTRE ENCYCLIQUE
DE SA SAINTETÉ LE PAPE PIE X
SUR LES ERREURS DU MODERNISME
Aux Patriarches, Primats, Archevêques et Evêques, en grâce et communion avec le Siège Apostolique.
Vénérables Frères,
Salut et Bénédiction Apostolique.
1. A la mission qui Nous a été confiée d’en haut de paître le troupeau du Seigneur, Jésus-Christ a assigné comme premier devoir de garder avec un soin jaloux le dépôt traditionnel de la foi, à l’encontre des profanes nouveautés de langage comme des contradictions de la fausse science. Nul âge, sans doute, où une telle vigilance ne fût nécessaire au peuple chrétien: car il n’a jamais manqué, suscités par l’ennemi du genre humain, d’hommes au langage pervers (1), diseurs de nouveautés et séducteurs (2), sujets de l’erreur et entraînant à l’erreur (3). Mais, il faut bien le reconnaître, le nombre s’est accru étrangement, en ces derniers temps, des ennemis de la Croix de Jésus-Christ qui, avec un art tout nouveau et souverainement perfide, s’efforcent d’annuler les vitales énergies de l’Eglise, et même, s’ils le pouvaient, de renverser de fond en comble le règne de Jésus-Christ. Nous taire n’est plus de mise, si Nous voulons ne point paraître infidèle au plus sacré de Nos devoirs, et que la bonté dont Nous avons usé jusqu’ici, dans un espoir d’amendement, ne soit taxée d’oubli de Notre charge.
2. Ce qui exige surtout que Nous parlions sans délai, c’est que, les artisans d’erreurs, il n’y a pas à les chercher aujourd’hui parmi les ennemis déclarés. Ils se cachent et c’est un sujet d’appréhension et d’angoisse très vives, dans le sein même et au coeur de l’Eglise, ennemis d’autant plus redoutables qu’ils le sont moins ouvertement. Nous parlons, Vénérables Frères, d’un grand nombre de catholiques laïques, et, ce qui est encore plus à déplorer, de prêtres, qui, sous couleur d’amour de l’Eglise, absolument courts de philosophie et de théologie sérieuses, imprégnés au contraire jusqu’aux moelles d’un venin d’erreur puisé chez les adversaires de la foi catholique, se posent, au mépris de toute modestie, comme rénovateurs de l’Eglise; qui, en phalanges serrées, donnent audacieusement l’assaut à tout ce qu’il y a de plus sacré dans l’oeuvre de Jésus-Christ, sans respecter sa propre personne, qu’ils abaissent, par une témérité sacrilège, jusqu’à la simple et pure humanité.
3. Ces hommes-là peuvent s’étonner que Nous les rangions parmi les ennemis de l’Eglise. Nul ne s’en étonnera avec quelque fondement qui, mettant leurs intentions à part, dont le jugement est réservé à Dieu, voudra bien examiner leurs doctrines, et, conséquemment à celles-ci, leur manière de parler et d’agir.
Ennemis de l’Eglise, certes ils le sont, et à dire qu’elle n’en a pas de pires on ne s’écarte pas du vrai. Ce n’est pas du dehors, en effet, on l’a déjà noté, c’est du dedans qu’ils trament sa ruine; le danger est aujourd’hui presque aux entrailles mêmes et aux veines de l’Eglise; leurs coups sont d’autant plus sûrs qu’ils savent mieux où la frapper. Ajoutez que ce n’est point aux rameaux ou aux rejetons qu’ils ont mis la cognée, mais à la racine même, c’est-à-dire à la foi et à ses fibres les plus profondes. Puis, cette racine d’immortelle vie une fois tranchée, ils se donnent la tâche de faire circuler le virus par tout l’arbre: nulle partie de la foi catholique qui reste à l’abri de leur main, nulle qu’ils ne fassent tout pour corrompre. Et tandis qu’ils poursuivent par mille chemins leur dessein néfaste, rien de si insidieux, de si perfide que leur tactique: amalgamant en eux le rationaliste et le catholique, ils le font avec un tel raffinement d’habileté qu’ils abusent facilement les esprits mal avertis. D’ailleurs, consommés en témérité, il n’est sorte de conséquences qui les fasse reculer, ou plutôt qu’ils ne soutiennent hautement et opiniâtrement.
Avec cela, et chose très propre à donner le change, une vie toute d’activité, une assiduité et une ardeur singulières à tous les genres d’études, des moeurs recommandables d’ordinaire pour leur sévérité. Enfin, et ceci parait ôter tout espoir de remède, leurs doctrines leur ont tellement perverti l’âme qu’ils en sont devenus contempteurs de toute autorité, impatients de tout frein : prenant assiette sur une conscience faussée, ils font tout pour qu’on attribue au pur zèle de la vérité ce qui est oeuvre uniquement d’opiniâtreté et d’orgueil. Certes, Nous avions espéré qu’ils se raviseraient quelque jour : et, pour cela, Nous avions usé avec eux d’abord de douceur, comme avec des fils, puis de sévérité : enfin, et bien à contrecoeur, de réprimandes publiques. Vous n’ignorez pas, Vénérables Frères, la stérilité de Nos efforts; ils courbent un moment la tête, pour la relever aussitôt plus orgueilleuse. Ah! s’il n’était question que d’eux, Nous pourrions peut-être dissimuler; mais c’est la religion catholique, sa sécurité qui sont en jeu. Trêve donc au silence, qui désormais serait un crime! Il est temps de lever le masque à ces hommes-là et de les montrer à l’Église universelle tels qu’ils sont.
4. Et comme une tactique des modernistes (ainsi les appelle-t-on communément et avec beaucoup de raison), tactique en vérité fort insidieuse, est de ne jamais exposer leurs doctrines méthodiquement et dans leur ensemble, mais de les fragmenter en quelque sorte et de les éparpiller çà et là, ce qui prête à les faire juger ondoyants et indécis, quand leurs idées, au contraire, sont parfaitement arrêtées et consistantes, il importe ici et avant tout de présenter ces mêmes doctrines sous une seule vue, et de montrer le lien logique qui les rattache entre elles. Nous Nous réservons d’indiquer ensuite les causes des erreurs et de prescrire les remèdes propres à retrancher le mal.
5. Et pour procéder avec clarté dans une matière en vérité fort complexe, il faut noter tout d’abord que les modernistes assemblent et mélangent pour ainsi dire en eux plusieurs personnages: c’est à savoir, le philosophe, le croyant, le théologien, l’historien, le critique, l’apologiste, le réformateur : personnages qu’il importe de bien démêler si l’on veut connaître à fond leur système et se rendre compte des principes comme des conséquences de leurs doctrines.
6. Et pour commencer par le philosophe, les modernistes posent comme base de leur philosophie religieuse la doctrine appelée communément agnosticisme. La raison humaine, enfermée rigoureusement dans le cercle des phénomènes, c’est-à-dire des choses qui apparaissent, et telles précisément qu’elles apparaissent, n’a ni la faculté ni le droit d’en franchir les limites; elle n’est donc pas capable de s’élever jusqu’à Dieu, non pas même pour en connaître, par le moyen des créatures, l’existence: telle est cette doctrine. D’où ils infèrent deux choses: que Dieu n’est point objet direct de science; que Dieu n’est point un personnage historique.
Qu’advient-il, après cela, de la théologie naturelle, des motifs de crédibilité, de la révélation extérieure ? Il est aisé de le comprendre. Ils les suppriment purement et simplement et les renvoient à l’intellectualisme, système, disent-ils, qui fait sourire de pitié, et dès longtemps périmé. Rien ne les arrête, pas même les condamnations dont l’Eglise a frappé ces erreurs monstrueuses: car le Concile du Vatican a décrété ce qui suit : Si quelqu’un dit que la lumière naturelle de l’humaine raison est incapable de faire connaître avec certitude, par le moyen des choses créées le seul et vrai Dieu, notre Créateur et Maître, qu’il soit anathème (4). Et encore : Si quelqu’un dit qu’il ne se peut faire, ou qu’il n’est pas expédient que l’homme soit instruit par révélation divine du culte à rendre à Dieu, qu’il soit anathème (5). Et enfin: Si quelqu’un dit que la révélation divine ne peut être rendue croyable par des signes extérieurs, et que ce n’est donc que par l’expérience individuelle ou par l’inspiration privée que les hommes sont mus à la foi, qu’il soit anathème (6).
Maintenant, de l’agnosticisme, qui n’est après tout qu’ignorance, comment les modernistes passent-ils à l’athéisme scientifique et historique, dont la négation fait au contraire tout le caractère; de ce qu’ils ignorent si Dieu est intervenu dans l’histoire du genre humain, par quel artifice de raisonnement en viennent-ils à expliquer cette même histoire absolument en dehors de Dieu, qui est tenu pour n’y avoir point eu effectivement de part ? Le comprenne qui pourra. Toujours est-il qu’une chose, pour eux, parfaitement entendue et arrêtée, c’est que la science doit être athée, pareillement l’histoire; nulle place dans le champ de l’une, comme de l’autre, sinon pour les phénomènes: Dieu et le divin en sont bannis.
Quelles conséquences découlent de cette doctrine absurde, au regard de la personne sacrée du Sauveur, des mystères de sa vie et de sa mort, de sa résurrection et de son ascension glorieuse, c’est ce que nous verrons bientôt.
7. L’agnosticisme n’est que le côté négatif dans la doctrine des modernistes ; le côté positif est constitué par ce qu’on appelle l’immanence vitale. Ils passent de l’un à l’autre en la manière que voici. Naturelle ou surnaturelle, la religion, comme tout autre fait, demande une explication. Or, la théologie naturelle une fois répudiée, tout accès à la révélation fermé par le rejet des motifs de crédibilité, qui plus est, toute révélation extérieure entièrement abolie, il est clair que, cette explication, on ne doit pas la chercher hors de l’homme.
C’est dans l’homme même qu’elle se trouve, et, comme la religion est une forme de vie, dans la vie même de l’homme.
Voilà l’immanence religieuse.
Or, tout phénomène vital – et, on l’a dit, telle est la religion – a pour premier stimulant une nécessité, un besoin; pour première manifestation, ce mouvement du coeur appelé sentiment.
Il s’ensuit, puisque l’objet de la religion est Dieu, que la foi, principe et fondement de toute religion, réside dans un certain sentiment intime engendré lui-même par le besoin du divin. Ce besoin, d’ailleurs, ne se trahissant que dans de certaines rencontres déterminées et favorables, n’appartient pas de soi au domaine de la conscience: dans le principe, il gît au-dessous, et, selon un vocable emprunté de la philosophie moderne, dans la subconscience, où il faut ajouter que sa racine reste cachée, entièrement inaccessible à l’esprit.
Veut-on savoir maintenant en quelle manière ce besoin du divin, si l’homme vient à l’éprouver, se tourne finalement en religion ?
Les modernistes répondent: « La science et l’histoire sont enfermées entre deux bornes: l’une extérieure, du monde visible; l’autre intérieure, de la conscience. Parvenues là, impossible à elles de passer outre: au-delà, c’est l’inconnaissable. Justement, en face de cet inconnaissable, de celui, disons-nous, qui est hors de l’homme, par delà la nature visible, comme de celui qui est en l’homme même, dans les profondeurs de la subconscience, sans nul jugement préalable (ce qui est du pur fidéisme), le besoin du divin suscite dans l’âme portée à la religion un sentiment particulier. Ce sentiment a ceci de propre qu’il enveloppe Dieu et comme objet et comme cause intime, et qu’il unit en quelque façon l’homme avec Dieu. »
Telle est, pour les modernistes, la foi, et dans la foi ainsi entendue le commencement de toute religion.
8. Là ne se borne pas leur philosophie, ou, pour mieux dire, leurs divagations.
Dans ce sentiment ils trouvent donc la foi ; mais aussi, avec la foi et dans la foi, la révélation.
Et pour la révélation, en effet, que veut-on de plus? Ce sentiment qui apparaît dans la conscience, et Dieu qui, dans ce sentiment, quoique confusément encore, se manifeste à l’âme, n’est-ce point là une révélation, ou tout au moins un commencement de révélation? Même si l’on y regarde bien, du moment que Dieu est tout ensemble cause et objet de la foi, dans la foi on trouve donc la révélation, et comme venant de Dieu et comme portant sur Dieu, c’est-à-dire que Dieu y est dans le même temps révélateur et révélé. De là, Vénérables Frères, cette doctrine absurde des modernistes, que toute religion est à la fois naturelle et surnaturelle, selon le point de vue. De là, l’équivalence entre la conscience et la révélation. De là, enfin, la loi qui érige la conscience religieuse en règle universelle, entièrement de pair avec la révélation, et à laquelle tout doit s’assujettir, jusqu’à l’autorité suprême dans sa triple manifestation, doctrinale, culturelle, disciplinaire.
9. On ne donnerait pas une idée complète de l’origine de la foi et de la révélation, telle que l’entendent les modernistes, si l’on n’attirait l’attention sur un point fort important, à raison des conséquences historico-critiques qu’ils en tirent.
Il ne faut pas croire que l’inconnaissable s’offre à la foi isolé et nu ; il est, au contraire, relié étroitement à un phénomène qui, pour appartenir au domaine de la science et de l’histoire, ne laisse pas de le déborder par quelque endroit : ce sera un fait de la nature, enveloppant quelque mystère; ce sera encore un homme dont le caractère, les actes, les paroles paraissent déconcerter les communes lois de l’histoire. Or, voici ce qui arrive: l’inconnaissable, dans sa liaison avec un phénomène, venant à amorcer la foi, celle-ci s’étend au phénomène lui-même et le pénètre en quelque sorte de sa propre vie. Deux conséquences en dérivent. Il se produit, en premier lieu, une espèce de transfiguration du phénomène que la foi hausse au-dessus de lui-même et de sa vraie réalité, comme pour le mieux adapter, ainsi qu’une matière, à la forme divine qu’elle veut lui donner. Il s’opère en second lieu une espèce de défiguration du phénomène, s’il est permis d’employer ce mot, en ce que la foi, l’ayant soustrait aux conditions de l’espace et du temps, en vient à lui attribuer des choses qui, selon la réalité, ne lui conviennent point. Ce qui arrive surtout, quand il s’agit d’un phénomène du passé, et d’autant plus aisément que ce passé est plus lointain. De cette double opération, les modernistes firent deux lois qui, ajoutées à une troisième, déjà fournie par l’agnosticisme, forment comme les bases de leur critique historique. Un exemple éclaircira la chose, et Jésus-Christ va nous le fournir. Dans la personne du Christ, disent-ils, la science ni l’histoire ne trouvent autre chose qu’un homme. De son histoire, donc, au nom de la première loi, basée sur l’agnosticisme, il faut effacer tout ce qui a caractère de divin. La personne historique du Christ a été transfigurée par la foi: il faut donc retrancher encore de son histoire, de par la seconde loi, tout ce qui l’élève au-dessus des conditions historiques. Enfin, la même personne du Christ a été défigurée par la foi: il faut donc, en vertu de la troisième loi, écarter en outre de son histoire les paroles, les actes, en un mot, tout ce qui ne répond point à son caractère, à sa condition, à son éducation, au lieu et au temps où il vécut.
10. Etrange paraîtra, sans doute, cette façon de raisonner: telle est pourtant la critique moderniste.
11. Le sentiment religieux, qui jaillit ainsi, par immanence vitale, des profondeurs de la subconscience, est le germe de toute religion, comme il est la raison de tout ce qui a été ou sera jamais, en aucune religion. Obscur, presque informe, à l’origine, ce sentiment est allé progressant sous l’influence secrète du principe qui lui donna l’être, et de niveau avec la vie humaine, dont on se rappelle qu’il est une forme. Ainsi naquirent toutes les religions, y compris les religions surnaturelles: elles ne sont toutes que des efflorescences de ce sentiment. Et que l’on n’attende pas une exception en faveur de la religion catholique: elle est mise entièrement sur le pied des autres. Son berceau fut la conscience de Jésus-Christ, homme de nature exquise, comme il n’en fut ni n’en sera jamais ; elle est née là, non d’un autre principe que de l’immanence vitale. On est saisi de stupeur en face d’une telle audace dans l’assertion, d’une telle aisance dans le blasphème. Et ce ne sont point les incrédules seuls, Vénérables Frères, qui profèrent de telles témérités: ce sont des catholiques, ce sont des prêtres même, et nombreux, qui les publient avec ostentation. Et dire qu’ils se targuent, avec de telles insanités, de rénover l’Eglise! Certes, il ne s’agit plus de la vieille erreur qui dotait la nature humaine d’une espèce de droit à l’ordre surnaturel. Que cela est dépassé! En l’homme qui est Jésus-Christ, aussi bien qu’en nous, notre sainte religion n’est autre chose qu’un fruit simple et spontané de la nature. Y a-t-il rien, en vérité, qui détruise plus radicalement l’ordre surnaturel? C’est donc avec souverainement de raison que le Concile du Vatican a décrété ce qui suit: Si quelqu’un dit que l’homme ne peut être élevé à une connaissance et à une perfection qui surpassent la nature, mais qu’il peut et qu’il doit, par un progrès continu, parvenir enfin de lui-même à la possession de tout vrai et de tout bien, qu’il soit anathème (7).
12. Nous n’avons vu jusqu’ici, Vénérables Frères, aucune place faite à l’intelligence. Selon les modernistes, elle a pourtant sa part dans l’acte de foi, et il importe de dire laquelle. Le sentiment dont il a été question – précisément parce qu’il est sentiment et non connaissance – fait bien surgir Dieu en l’homme, mais si confusément encore que Dieu, à vrai dire, ne s’y distingue pas, ou à peine, de l’homme lui-même. Ce sentiment, il faut donc qu’une lumière le vienne irradier, y mettre Dieu en relief dans une certaine opposition avec le sujet. C’est l’office de l’intelligence, faculté de pensée et d’analyse, dont l’homme se sert pour traduire, d’abord en représentations intellectuelles, puis en expressions verbales, les phénomènes de la vie dont il est le théâtre.
De là ce mot devenu banal chez les modernistes : l’homme doit penser sa foi.
L’intelligence survient donc au sentiment et, se penchant en quelque sorte sur lui, y opère à la façon d’un peintre qui, sur une toile vieillie, retrouverait et ferait reparaître les lignes effacées du dessin ; telle est, à peu de chose près, la comparaison fournie par l’un des maîtres des modernistes.
Or, en ce travail, l’intelligence a un double procédé : d’abord, par un acte naturel et spontané, elle traduit la chose en une assertion simple et vulgaire; puis, faisant appel à la réflexion et à l’étude, travaillant sur sa pensée, comme ils disent, elle interprète la formule primitive au moyen de formules dérivées, plus approfondies et plus distinctes. Celles-ci, venant à être sanctionnées par le magistère de l’Église, constitueront le dogme.
13. Le dogme, son origine, sa nature, tel est le point capital dans la doctrine des modernistes. Le dogme, d’après eux, tire son origine des formules primitives et simples, essentielles, sous un certain rapport, à la foi, car la révélation, pour être vraie, demande une claire apparition de Dieu dans la conscience. Le dogme lui-même, si on les comprend bien, est contenu proprement dans les formules secondaires. Maintenant, pour bien entendre sa nature, il faut voir avant tout quelle sorte de rapport il y a entre les formules religieuses et le sentiment religieux.
Ce qui ne sera pas malaisé à découvrir si l’on se reporte au but de ces mêmes formules, qui est de fournir au croyant le moyen de se rendre compte de sa foi.
Elles constituent donc entre le croyant et sa foi une sorte d’entre-deux : par rapport à la foi, elles ne sont que des signes inadéquats de son objet, vulgairement des symboles ; par rapport au croyant, elles ne sont que de purs instruments.
D’où l’on peut déduire qu’elles ne contiennent point la vérité absolue comme symboles, elles sont des images de la vérité, qui ont à s’adapter au sentiment religieux dans ses rapports avec l’homme; comme instruments, des véhicules de vérité, qui ont réciproquement à s’accommoder à l’homme dans ses rapports avec le sentiment religieux. Et comme l’absolu, qui est l’objet de ce sentiment, a des aspects infinis, sous lesquels il peut successivement apparaître; comme le croyant, d’autre part, peut passer successivement sous des conditions fort dissemblables, il s’ensuit que les formules dogmatiques sont soumises à ces mêmes vicissitudes, partant sujettes à mutation.
Ainsi est ouverte la voie à la variation substantielle des dogmes. Amoncellement infini de sophismes, où toute religion trouve son arrêt de mort.
14. Evoluer et changer, non seulement le dogme le peut, il le doit: c’est ce que les modernistes affirment hautement et qui d’ailleurs découle manifestement de leurs principes. Les formules religieuses, en effet, pour être véritablement religieuses, non de simples spéculations théologiques, doivent être vivantes, et de la vie même du sentiment religieux; ceci est une doctrine capitale dans leur système, et déduite du principe de l’immanence vitale. Ne l’entendez pas en ce sens qu’il soit nécessaire de construire les formules, surtout si elles sont imaginatives, précisément en vue du sentiment: non, leur origine, leur nombre, jusqu’à un certain point leur qualité même, importent assez peu: ce qu’il faut, c’est que le sentiment, après les avoir convenablement modifiées, s’il y a lieu, se les assimile vitalement.
Ce qui revient à dire que la formule primitive demande à être acceptée et sanctionnée par le cœur; le travail subséquent, d’où s’engendrent les formules secondaires, à être fait sous la pression du coeur. C’est en cette vue surtout, c’est-à-dire afin d’être et de rester vivantes, qu’il est nécessaire qu’elles soient et qu’elles restent assorties et au croyant et à sa foi. Le jour où cette adaptation viendrait à cesser, ce jour-là elles se videraient du même coup de leur contenu primitif : il n’y aurait d’autre parti à prendre que de les changer. Etant donné le caractère si précaire et si instable des formules dogmatiques, on comprend à merveille que les modernistes les aient en si mince estime, s’ils ne les méprisent ouvertement. Le sentiment religieux, la vie religieuse, c’est ce qu’ils ont toujours aux lèvres, ce qu’ils exaltent sans fin. En même temps, ils réprimandent l’Eglise audacieusement, comme faisant fausse route, comme ne sachant pas discerner de la signification matérielle des formules leur sens religieux et moral, comme s’attachant opiniâtrement et stérilement à des formules vaines et vides, cependant qu’elles laissent la religion aller à sa ruine. Aveugles et conducteurs d’aveugles qui, enflés d’une science orgueilleuse, en sont venus à cette folie de pervertir l’éternelle notion de la vérité, en même temps que la véritable nature du sentiment religieux, inventeurs d’un système où on les voit, sous l’empire d’un amour aveugle et effréné de nouveauté, ne se préoccuper aucunement de trouver un point d’appui solide à la vérité, mais, méprisant les saintes et apostoliques traditions, embrasser d’autres doctrines vaines, futiles, incertaines, condamnées par l’Eglise, sur lesquelles, hommes très vains eux-mêmes, ils prétendent appuyer et asseoir la vérité (8).
15. Tel est, Vénérables Frères, le moderniste philosophe. Si maintenant, passant au croyant, nous voulons savoir en quoi, chez ce même moderniste, il se distingue du philosophe, une chose est premièrement à noter: c’est que le philosophe admet bien la réalité divine comme objet de la foi; mais cette réalité, pour lui, n’existe pas ailleurs que dans l’âme même du croyant, c’est-à-dire comme objet de son sentiment et de ses affirmations; ce qui ne sort pas, après tout, du monde des phénomènes. Si Dieu existe en soi, hors du sentiment et hors des affirmations, c’est de quoi il n’a cure: il en fait totalement abstraction. Pour le croyant, au contraire, Dieu existe en soi, indépendamment de lui, croyant, il en a la certitude, et c’est par là qu’il se distingue du philosophe. Si maintenant vous demandez sur quoi, en fin de compte, cette certitude repose, les modernistes répondent: Sur l’expérience individuelle. Ils se séparent ainsi des rationalistes, mais pour verser dans la doctrine des protestants et des pseudo-mystiques. Voici, au surplus, comme ils expliquent la chose. Si l’on pénètre le sentiment religieux, on y découvrira facilement une certaine intuition du coeur, grâce à laquelle, et sans nul intermédiaire, l’homme atteint la réalité même de Dieu: d’où une certitude de son existence, qui passe très fort toute certitude scientifique.
Et cela est une véritable expérience et supérieure à toutes les expériences rationnelles. Beaucoup, sans doute, la méconnaissent et la nient, tels les rationalistes : mais c’est tout simplement qu’ils refusent de se placer dans les conditions morales qu’elle requiert. Voilà donc, dans cette expérience, ce qui, d’après les modernistes, constitue vraiment et proprement le croyant.
16. Combien tout cela est contraire à la foi catholique, nous l’avons déjà vu dans un décret du Concile du Vatican ; comment la voie s’en trouve ouverte à l’athéisme, de même que par les autres erreurs déjà exposées, Nous le dirons plus loin. Ce que Nous voulons observer ici, c’est que la doctrine de l’expérience, jointe à l’autre du symbolisme, consacre comme vraie toute religion, sans en excepter la religion païenne. Est-ce qu’on ne rencontre pas dans toutes les religions, des expériences de ce genre? Beaucoup le disent. Or, de quel droit les modernistes dénieraient-ils la vérité aux expériences religieuses qui se font, par exemple, dans la religion mahométane? Et en vertu de quel principe attribueraient-ils aux seuls catholiques le monopole des expériences vraies? Ils s’en gardent bien : les uns d’une façon voilée, les autres ouvertement, ils tiennent pour vraies toutes les religions.
C’est aussi bien une nécessité de leur système. Car, posés leurs principes, à quel chef pourraient-ils arguer une religion de fausseté? Ce ne pourrait être évidemment que pour la fausseté du sentiment, ou pour celle de la formule. Mais, d’après eux, le sentiment est toujours et partout le même, substantiellement identique; quant à la formule religieuse, tout ce qu’on lui demande, c’est l’adaptation au croyant – quel que soit par ailleurs son niveau intellectuel – en même temps qu’à sa foi. Tout au plus, dans cette mêlée, des religions, ce qu’ils pourraient revendiquer en faveur de la religion catholique, c’est qu’elle est plus vraie, parce qu’elle est plus vivante; c’est encore qu’elle est plus digne du nom de chrétienne, parce qu’elle répond mieux que toute autre aux origines du christianisme.
De telles conclusions ne sauraient surprendre : elles découlent des prémisses.
Ce qui est fort étrange, c’est que des catholiques, c’est que des prêtres, dont Nous aimons à penser que de telles monstruosités leur font horreur, se comportent néanmoins, dans la pratique, comme s’ils les approuvaient pleinement: c’est que des catholiques, des prêtres, décernent de telles louanges, rendent de tels hommages aux coryphées de l’erreur, qu’ils prêtent à penser que ce qu’ils veulent honorer par là, c’est moins les hommes eux-mêmes, non indignes peut-être de toute considération, que les erreurs par eux ouvertement professées et dont ils se sont faits les champions.
17. Un autre point où les modernistes se mettent en opposition flagrante avec la foi catholique, c’est que le principe de l’expérience religieuse, ils le transfèrent à la tradition: et la tradition, telle que l’entend l’Eglise, s’en trouve ruinée totalement. Qu’est-ce que la tradition, pour les modernistes ? La communication faite à d’autres de quelque expérience originale, par l’organe de la prédication, et moyennant la formule intellectuelle. Car, à cette dernière, en sus de la vertu représentative, comme ils l’appellent, ils attribuent encore une vertu suggestive s’exerçant soit sur le croyant même pour réveiller en lui le sentiment religieux, assoupi peut-être, ou encore pour lui faciliter de réitérer les expériences déjà faites, soit sur les non-croyants pour engendrer en eux le sentiment religieux et les amener aux expériences qu’on leur désire. C’est ainsi que l’expérience religieuse va se propageant à travers les peuples, et non seulement parmi les contemporains par la prédication proprement dite, mais encore de génération en génération par l’écrit ou par la transmission orale. Or, cette communication d’expériences a des fortunes fort diverses : tantôt elle prend racine et s’implante, tantôt elle languit et s’éteint. C’est à cette épreuve, d’ailleurs, que les modernistes, pour qui vie et vérité ne sont qu’un, jugent de la vérité des religions: si une religion vit, c’est qu’elle est vraie; si elle n’était pas vraie, elle ne vivrait pas. D’où l’on conclut encore: toutes les religions existantes sont donc vraies.
18. Au point où nous en sommes, Vénérables Frères, nous avons plus qu’il ne faut pour nous faire une idée exacte des rapports qu’ils établissent entre la foi et la science, entendant aussi sous ce dernier mot l’histoire.
En premier lieu, leurs objets sont totalement étrangers entre eux, l’un en dehors de l’autre. Celui de la foi est justement ce que la science déclare lui être à elle-même inconnaissable. De là un champ tout divers: la science est toute aux phénomènes, la foi n’a rien à y voir ; la foi est toute au divin, cela est au-dessus de la science.
D’où l’on conclut enfin qu’entre la science et la foi il n’y a point de conflit possible; qu’elles restent chacune chez elle, et elles ne pourront jamais se rencontrer ni, partant, se contredire.
Que si l’on objecte à cela qu’il est certaines choses de la nature visible qui relèvent aussi de la foi, par exemple la vie humaine de Jésus-Christ, ils le nieront.
Il est bien vrai, diront-ils, que ces choses-là appartiennent par leur nature au monde des phénomènes; mais, en tant qu’elles sont pénétrées de la vie de la foi, et que, en la manière qui a été dite, elles sont transfigurées et défigurées par la foi, sous cet aspect précis les voilà soustraites au monde sensible et transportées en guise de matière, dans l’ordre divin. Ainsi à la demande si Jésus-Christ a fait de vrais miracles et de véritables prophéties; s’il est ressuscité et monté au ciel: non, répondra la science agnostique; oui, répondra la foi.
Où il faudra bien se garder pourtant de trouver une contradiction : la négation est du philosophe parlant à des philosophes et qui n’envisage Jésus-Christ que selon la réalité historique: l’affirmation est du croyant s’adressant à des croyants et qui considère la vie de Jésus-Christ comme vécue à nouveau par la foi et dans la foi.
19. Or, l’on se tromperait très fort si l’on s’imaginait après cela que, entre la science et la foi, il n’existe de subordination d’aucune sorte. C’est fort bien et fort justement pensé de la science; mais non certes de la foi, assujettie qu’elle est à la science, non pas à un titre mais à trois. Il faut observer, premièrement, que, dans tout fait religieux, à la réserve de la réalité divine, et de l’expérience qu’en a le croyant, tout le reste, notamment les formules religieuses, ne dépasse point la sphère des phénomènes, n’est point soustrait par conséquent au domaine scientifique. Que le croyant s’exile donc du monde, s’il lui plaît ; mais, tant qu’il y reste, il doit subir les lois, le contrôle, le jugement de la science. En second lieu, si l’on a dit que la foi seule a Dieu pour objet, il faut l’entendre de la réalité divine, non de l’idée: car l’idée est tributaire de la science, attendu que celle-ci, dans l’ordre logique, comme on dit, s’élève jusqu’à l’absolu et à l’idéal.
A la science, donc, à la philosophie de connaître de l’idée de Dieu, de la guider dans son évolution et, s’il venait à s’y mêler quelque élément étranger, de la corriger. D’où cette maxime des modernistes que l’évolution religieuse doit se coordonner à l’évolution intellectuelle et morale, ou, pour mieux dire, et selon le mot d’un de leurs maîtres, s’y subordonner. Enfin, l’homme ne souffre point en soi de dualisme : aussi le croyant est-il stimulé par un besoin intime de synthèse à tellement harmoniser entre elles la science et la foi, que celle-ci ne contredise jamais à la conception générale que celle-là se fait de l’univers. Ainsi donc, vis-à-vis de la foi, liberté totale de la science; au contraire, et nonobstant qu’on les ait données pour étrangères l’une à l’autre, à la science asservissement de la foi.
Toutes choses, Vénérables Frères, qui sont en opposition formelle avec les enseignements de Notre prédécesseur Pie IX. Il écrivait, en effet, qu’il est de la philosophie, en tout ce qui regarde la religion, non de commander mais d’obéir, non de prescrire ce qui est à croire, mais de l’embrasser avec une soumission que la raison éclaire, de ne point scruter les profondeurs des mystères de Dieu mais de les révérer en toute piété et humilité (9). Les modernistes renversent cet ordre, et méritent qu’on leur applique ce que Grégoire IX, un autre de Nos prédécesseurs, écrivait de certains théologiens de son temps: Il en est parmi vous, gonflés d’esprit de vanité ainsi que des outres, qui s’efforcent de déplacer, par des nouveautés profanes, les bornes qu’ont fixées les Pères; qui plient les Saintes Lettres aux doctrines de la philosophie rationnelle, par pure ostentation de science, sans viser à aucun profit des auditeurs…; qui, séduits par d’insolites et bizarres doctrines, mettent queue en tête et à la servante assujettissent la reine (10).
20. Ce qui jettera plus de jour encore sur ces doctrines des modernistes, c’est leur conduite, qui y est pleinement conséquente. À les entendre, à les lire, on serait tenté de croire qu’ils tombent en contradiction avec eux-mêmes, qu’ils sont oscillants et incertains. Loin de là : tout est pesé, tout est voulu chez eux, mais à la lumière de ce principe que la foi et la science sont l’une à l’autre étrangères. Telle page de leur ouvrage pourrait être signée par un catholique: tournez la page, vous croyez lire un rationaliste. Écrivent-ils histoire : nulle mention de la divinité de Jésus-Christ: montent-ils dans la chaire sacrée, ils la proclament hautement. Historiens, ils dédaignent Pères et Conciles: catéchistes, ils les citent avec honneur. Si vous y prenez garde, il y a pour eux deux exégèses fort distinctes : l’exégèse théologique et pastorale, l’exégèse scientifique et historique. De même, en vertu de ce principe que la science ne relève à aucun titre de la foi, s’ils dissertent de philosophie, d’histoire, de critique, ils affichent en mille manières – n’ayant pas horreur de marcher en cela sur les traces de Luther (11) – leur mépris des enseignements catholiques, des saints Pères, des Conciles oecuméniques, du magistère ecclésiastique; réprimandés sur ce point, ils jettent les hauts cris, se plaignant amèrement qu’on viole leur liberté. Enfin, vu que la foi est subordonnée à la science, ils reprennent l’Eglise – ouvertement et en toute rencontre – de ce qu’elle s’obstine à ne point assujettir et accommoder les dogmes aux opinions des philosophes; quant à eux, après avoir fait table rase de l’antique théologie, ils s’efforcent d’en introduire une autre, complaisante celle-ci, aux divagations de ces mêmes philosophes.
21. Ici, Vénérables Frères, se présente à nous le moderniste théologien. La matière est vaste et compliquée: Nous la condenserons en peu de mots. Ce dont il s’agit, c’est de concilier la science et la foi, tout naturellement par subordination de la foi à la science. La méthode du moderniste théologien est tout entière à prendre les principes du philosophe et à les adapter au croyant: et c’est à savoir, les principes de l’immanence et du symbolisme. Fort simple est le procédé. Le philosophe disait: Le principe de la loi est immanent; le croyant ajoutait: Ce principe est Dieu; le théologien conclut: Dieu est donc immanent dans l’homme. Immanence théologique.
De même, le philosophe disait: Les représentations de l’objet de la loi sont de purs symboles; le croyant ajoutait: L’objet de la loi est Dieu en soi; le théologien conclut: Les représentations de la réalité divine sont donc purement symboliques. Symbolisme théologique. Insignes erreurs, plus pernicieuses l’une que l’autre, ainsi qu’on va le voir clairement par les conséquences.
Et, pour commencer par le symbolisme, comme les symboles sont tout ensemble et symboles au regard de l’objet et instruments au regard du sujet, il découle de là deux conséquences: la première, c’est que le croyant ne doit point adhérer précisément à la formule, en tant que formule, mais en user purement pour atteindre à la vérité absolue, que la formule voile et dévoile en même temps qu’elle fait effort pour exprimer, sans y parvenir jamais. La seconde, c’est que le croyant doit employer ces formules dans la mesure où elles peuvent lui servir, car c’est pour seconder sa foi, non pour l’entraver, qu’elles lui sont données; sous réserve toujours du respect social qui leur est dû, pour autant que le magistère public les aura jugées aptes à traduire la conscience commune, et jusqu’à ce qu’il ait réformé ce jugement.
22. Pour ce qui est de l’immanence, il est assez malaisé de savoir sur ce point la vraie pensée des modernistes, tant leurs opinions y sont divergentes. Les uns l’entendent en ce sens que Dieu est plus présent à l’homme que l’homme n’est présent à lui-même, ce qui, sainement compris, est irréprochable. D’autres veulent que l’action de Dieu ne fasse qu’un avec l’action de la nature, la cause première pénétrant la cause seconde, ce qui est en réalité la ruine de l’ordre surnaturel. D’autres enfin expliquent tellement la chose qu’ils se font soupçonner d’interprétation panthéiste: ceux-ci sont d’accord avec eux-mêmes et vraiment logiques.
23. A ce principe d’immanence il s’en rattache un autre que l’on peut appeler de permanence divine; il diffère du premier à peu près comme l’expérience transmise par tradition de la simple expérience individuelle. Un exemple éclaircira la chose, et il sera tiré de l’Eglise et des sacrements. Il ne faut pas s’imaginer, disent-ils, que les sacrements et l’Eglise aient été institués immédiatement par Jésus-Christ. Cela est en contradiction avec l’agnosticisme qui, en Jésus-Christ, ne voit autre chose qu’un homme, dont la conscience, à l’instar de toute conscience humaine, est allée se formant peu à peu : avec la loi d’immanence, qui répudie les applications faites du dehors, comme ils disent; avec la loi d’évolution, qui demande du temps pour le développement des germes, ainsi qu’une série changeante de circonstances; avec l’histoire, enfin, qui constate que les choses se sont passées effectivement selon les exigences de ces lois. Ce qui n’empêche point, et il faut l’affirmer, que l’Eglise et les sacrements aient été institués médiatement par Jésus-Christ. Voici de quelle manière. Toutes les consciences chrétiennes furent enveloppées en quelque sorte dans la conscience du Christ, ainsi que la plante dans son germe. Et de même que les rejetons vivent de la vie du germe, ainsi faut-il dire que tous les chrétiens vivent de la vie de Jésus-Christ. Or, la vie de Jésus-Christ est divine, selon la foi; divine sera donc aussi la vie des chrétiens. Et c’est pourquoi, s’il arrive que la vie chrétienne, dans la suite des temps, donne naissance aux sacrements et à l’Eglise, on pourra affirmer en toute vérité que l’origine en vient de Jésus-Christ et qu’elle est divine. C’est par le même procédé que la divinité sera octroyée aux Saintes Ecritures, qu’elle le sera aux dogmes. Là se borne à peu près la théologie des modernistes: mince bagage sans doute, mais plus que suffisant si l’on tient, avec eux, que la foi doit en passer par tous les caprices de la science.
24. De tout ceci, Nous laisserons à chacun le soin d’en faire l’application à ce qui va suivre, elle est aisée.
25. Nous avons surtout parlé jusqu’ici de l’origine et de la nature de la foi. Or, dans le système des modernistes, la foi a plusieurs rejetons, dont voici les principaux: l’Eglise, le dogme, le culte, les Livres Saints. Voyons ce qu’ils en disent. Pour commencer par le dogme, il est si connexe avec la foi que Nous avons déjà dû en retracer plus haut l’origine et la nature. Il naît du besoin qu’éprouve le croyant de travailler sur sa pensée religieuse, en vue d’éclairer de plus en plus et sa propre conscience et celle des autres. Ce travail consiste à pénétrer et à expliquer la formule primitive: ce qui ne doit point s’entendre d’un développement d’ordre rationnel et logique, mais commandé entièrement par les circonstances: ils l’appellent, d’un mot assez obscur pour qui n’est pas au fait de leur langage, vital. Il arrive ainsi qu’autour de la formule primitive naissent peu à peu des formules secondaires: organisées par la suite en corps de doctrine, ou, pour parler avec eux, en constructions doctrinales, sanctionnées en outre par le magistère public, comme répondant à la conscience commune, elles recevront le nom de dogme. Du dogme il faut distinguer avec soin les pures spéculations théologiques. Celles-ci, d’ailleurs, pour n’être point vivantes, à proprement parler, de la vie de la foi, ne laissent pas d’avoir leur utilité: elles servent à concilier la religion avec la science, à supprimer entre elles tout conflit; de même à éclairer extérieurement la religion, à la défendre : elles peuvent enfin constituer une matière en préparation pour un dogme futur.
Du culte il y aurait peu à dire, si ce n’était que sous ce mot sont compris les Sacrements; et sur les Sacrements les modernistes greffent de fort graves erreurs. Le culte naît d’une double nécessité, d’un double besoin: car, on l’a remarqué, la nécessité, le besoin, telle est, dans leur système, la grande et universelle explication.
Le premier besoin, ici, est de donner à la religion un corps sensible; le second, de la propager, à quoi il ne faudrait pas songer sans formes sensibles ni sans les actes sanctifiants que l’on appelle sacrements. Les sacrements, pour les modernistes, sont de purs signes ou symboles, bien que doués d’efficacité. Ils les comparent à de certaines paroles, dont on dit vulgairement qu’elles ont fait fortune parce qu’elles ont la vertu de faire rayonner des idées fortes et pénétrantes, qui impressionnent et remuent. Comme ces paroles sont à ces idées, de même les sacrements au sentiment religieux. Rien de plus. Autant dire, en vérité, et plus clairement, que les sacrements n’ont été institués que pour nourrir la foi: proposition condamnée par le Concile de Trente: Si quelqu’un dit que les sacrements n’ont été institués que pour nourrir la foi, qu’il soit anathème (12).
26. De l’origine et de la nature des Livres Saints Nous avons déjà touché quelque chose. Ils ne constituent, non plus, que de simples rejetons de la foi. Si l’on veut les définir exactement, on dira qu’ils sont le recueil des expériences faites dans une religion donnée, non point d’expériences à la portée de tous et vulgaires, mais extraordinaires et insignes. Ceci est dit de nos Livres Saints de l’Ancien et du Nouveau Testament, aussi bien que des autres.
Et une remarque qu’ils ajoutent, fort avisée à leur point de vue, c’est que si l’expérience roule toujours sur le présent, elle peut puiser néanmoins sa matière et dans le passé et dans l’avenir, attendu que le croyant vit, sous la forme du présent, et les choses du passé qu’il fait renaître par le souvenir, et celles de l’avenir qu’il anticipe par la prévision. De là, parmi les Livres Saints, les Livres historiques et les apocalyptiques.
C’est Dieu qui parle dans ces Livres, par l’organe du croyant, mais, selon la théologie moderniste, par voie d’immanence et de permanence vitale.
Demande-t-on ce qu’il en est de l’inspiration? L’inspiration, répondent-ils, ne diffère pas, si ce n’est par l’intensité, de ce besoin qu’éprouve tout croyant de communiquer sa foi, par l’écrit ou par la parole. On trouve quelque chose de semblable dans l’inspiration poétique, et on se souvient du mot fameux: Un Dieu est en nous; de lui qui nous agite vient cette flamme.
C’est ainsi que Dieu, dans leur doctrine, est le principe de l’inspiration des Saints Livres.
Cette inspiration, ajoutent-ils, rien, dans ces mêmes Livres, qui lui échappe. En quoi vous les croiriez plus orthodoxes que certaines autres de ce temps, qui la rétrécissent quelque peu, en lui dérobant, par exemple, ce qu’ils appellent les citations tacites. Jonglerie de mots et apparences pures. Si l’on commence par déclarer, selon les principes de l’agnosticisme, que la Bible est un ouvrage humain, écrit par des hommes et pour des hommes : sauf à les dire théologiquement divins par immanence, le moyen de rétrécir l’inspiration? Universelle, l’inspiration, oui, au sens moderniste ; nulle, au sens catholique.
27. Nous voici à l’Eglise, où leurs fantaisies vont nous offrir plus ample matière.
L’Eglise est née d’un double besoin: du besoin qu’éprouve tout fidèle, surtout s’il a eu quelque expérience originale, de communiquer sa foi; ensuite, quand la foi est devenue commune, ou, comme on dit, collective, du besoin de s’organiser en société, pour conserver, accroître, propager le trésor commun.
Alors, qu’est-ce donc que l’Eglise ?
Le fruit de la conscience collective, autrement dit de la collection des consciences individuelles: consciences qui, en vertu de la permanence vitale, dérivent d’un premier croyant – pour les catholiques, de Jésus-Christ.
Or, toute société a besoin d’une autorité dirigeante, qui guide ses membres à la fin commune, qui, en même temps, par une action prudemment conservatrice, sauvegarde ses éléments essentiels, c’est-à-dire, dans la société religieuse, le dogme et le culte. De là, dans l’Eglise catholique, le triple pouvoir: disciplinaire, doctrinal, liturgique. De l’origine de cette autorité se déduit sa nature; comme de sa nature ensuite, ses droits et ses devoirs. Aux temps passés, c’était une erreur commune que l’autorité fût venue à l’Eglise du dehors, savoir de Dieu immédiatement : en ce temps-là, on pouvait à bon droit la regarder comme autocratique. Mais on en est bien revenu aujourd’hui. De même que l’Eglise est une émanation vitale de la conscience collective, de même, à son tour, l’autorité est un produit vital de l’Eglise.
La conscience religieuse, tel est donc le principe d’où l’autorité procède, tout comme l’Eglise, et, s’il en est ainsi, elle en dépend. Vient-elle à oublier ou méconnaître cette dépendance, elle tourne en tyrannie. Nous sommes à une époque où le sentiment de la liberté est en plein épanouissement dans l’ordre civil, la conscience publique a créé le régime populaire. Or il n’y a pas deux consciences dans l’homme, non plus que deux vies. Si l’autorité ecclésiastique ne veut pas, au plus intime des consciences, provoquer et fomenter un conflit, à elle de se plier aux formes démocratiques. Au surplus, à ne le point faire, c’est la ruine. Car il y aurait folie à s’imaginer que le sentiment de la liberté, au point où il en est, puisse reculer. Enchaîné de force et contraint, terrible serait son explosion; elle emporterait tout, Eglise et religion. Telles sont, en cette matière, les idées des modernistes, dont c’est, par suite, le grand souci de chercher une voie de conciliation entre l’autorité de l’Eglise et la. liberté des croyants.
28. Mais l’Eglise n’a pas seulement à s’entendre amicalement avec les siens; ses rapports ne se bornent pas au dedans; elle en a encore avec le dehors. Car, elle n’occupe pas seule le monde; en regard, il y a d’autres sociétés, avec qui elle ne peut se dispenser de communiquer et d’avoir commerce. Vis-à-vis de celles-ci, quels sont donc ses droits et ses devoirs; c’est ce qu’il s’agit de déterminer, et non pas sur d’autre principe, bien entendu, que sa nature même, telle qu’ils l’ont décrite.
Les règles qu’ils appliquent sont les mêmes que pour la science et la foi, sauf que là il s’agissait d’objet, ici de fins. De même donc que la foi et la science sont étrangères l’une à l’autre, à raison de la diversité des objets; de même, l’Eglise et l’Etat, à raison de la diversité des fins, spirituelle pour l’Eglise, temporelle pour l’Etat.
Autrefois, on a pu subordonner le temporel au spirituel; on a pu parler de questions mixtes, où l’Eglise apparaissait comme reine, maîtresse. La raison en est que l’on tenait alors l’Eglise comme instituée directement de Dieu, en tant qu’il est auteur de l’ordre surnaturel. Mais cette doctrine, aujourd’hui, philosophie et histoire s’accordent à la répudier. Donc séparation de l’Eglise et de l’Etat, du catholique et du citoyen. Tout catholique, car il est en même temps citoyen, a le droit et le devoir, sans se préoccuper de l’autorité de l’Eglise, sans tenir compte de ses désirs, de ses conseils, de ses commandements, au mépris même de ses réprimandes, de poursuivre le bien public en la manière qu’il estime la meilleure. Tracer et prescrire au citoyen une ligne de conduite, sous un prétexte quelconque, est un abus de la puissance ecclésiastique, contre lequel c’est un devoir de réagir de toutes ses forces.
29. Les principes dont toutes ces doctrines dérivent ont été solennellement condamnés par Pie VI, Notre prédécesseur, dans sa Constitution Auctorem fidei (13).
30. Il ne suffit pas à l’écoute moderniste que l’Etat soit séparé de l’Eglise. De même que la foi doit se subordonner à la science, quant aux éléments phénoménaux, ainsi faut-il que dans les affaires temporelles l’Eglise s’assujettisse à l’Etat. Cela, ils ne le disent peut-être pas encore ouvertement, ils le diront quand sur ce point ils seront logiques. Posé, en effet, que dans les choses temporelles l’Etat est maître, s’il arrive que le croyant, aux actes intérieurs de religion, dont il ne se contente pas d’aventure, en veuille ajouter d’extérieurs, comme serait l’administration des sacrements, la conséquence nécessaire, c’est qu’ils tombent sous la domination de l’Etat.
Et que dire alors de l’autorité ecclésiastique, dont justement il n’est pas un seul acte qui ne se traduise à l’extérieur? Il faudra donc qu’elle lui soit totalement assujettie. C’est l’évidence de ces conclusions qui a amené bon nombre de protestants libéraux à rejeter tout culte extérieur, même toute société religieuse extérieure, et à essayer de faire prévaloir une religion purement individuelle. Si les modernistes n’en sont point encore arrivés là, ce qu’ils demandent, en attendant, c’est que l’Eglise veuille, sans trop se faire prier, suivre leurs directions, et qu’elle en vienne enfin à s’harmoniser avec les formes civiles.
31. Telles sont leurs idées sur l’autorité disciplinaire.
Quant à l’autorité doctrinale et dogmatique, bien plus avancées, bien plus pernicieuses sont sur ce point leurs doctrines. Veut-on savoir comment ils imaginent le magistère ecclésiastique? Nulle société religieuse disent-ils, n’a de véritable unité que si la conscience religieuse de ses membres est une, et une aussi la formule qu’ils adoptent.
Or, cette double unité requiert une espèce d’intelligence universelle, dont ce soit l’office de chercher et de déterminer la formule répondant le mieux à la conscience commune, qui ait en outre suffisamment d’autorité, cette formule une fois arrêtée, pour l’imposer à la communauté. De la combinaison et comme de la fusion de ces deux éléments, intelligence qui choisit la formule, autorité qui l’impose, résulte, pour les modernistes, la notion du magistère ecclésiastique. Et comme ce magistère a sa première origine dans les consciences individuelles, et qu’il remplit un service public pour leur plus grande utilité, il est de toute évidence qu’il s’y doit subordonner, par là même se plier aux formes populaires. Interdire aux consciences individuelles de proclamer ouvertement et hautement leurs besoins, bâillonner la critique, l’empêcher de pousser aux évolutions nécessaires, ce n’est donc plus l’usage d’une puissance commise pour des fins utiles, c’est un abus d’autorité.
Puis, l’usage de cette autorité ou puissance a besoin de se tempérer.
Condamner et proscrire un ouvrage à l’insu de l’auteur sans explication de sa part, sans discussion, cela véritablement confine à la tyrannie.
En somme, ici encore, il faut trouver une voie moyenne où soient assurés tout ensemble les droits de l’autorité et ceux de la liberté. En attendant, que fera le catholique? Il se proclamera hautement très respectueux de l’autorité mais sans se démentir le moins du monde, sans rien abdiquer de son caractère ni de ses idées.
Généralement, voici ce qu’ils imposent à l’Eglise.
Du moment que sa fin est toute spirituelle, l’autorité religieuse doit se dépouiller de tout cet appareil extérieur, de tous ces ornements pompeux par lesquels elle se donne comme en spectacle. En quoi ils oublient que la religion, si elle appartient à l’âme proprement, n’y est pourtant pas confinée, et que l’honneur rendu à l’autorité rejaillit sur Jésus-Christ, qui l’a instituée.
32. Pour épuiser toute cette matière de la foi et de ses rejetons, il nous reste à voir comment les modernistes entendent leur développement. Ils posent tout d’abord ce principe général que, dans une religion vivante, il n’est rien qui ne soit variable, rien qui ne doive varier.
D’où ils passent à ce que l’on peut regarder comme le point capital de leur système, savoir l’évolution.
Des lois de l’évolution, dogme, Eglise, culte, Livres Saints, foi même, tout est tributaire, sous peine de mort. Que l’on reprenne sur chacune de ces choses en particulier les enseignements des modernistes, et ce principe ne pourra surprendre. Quant à son application, quant à la mise en acte des lois de l’évolution, voici leur doctrine.
33. Et d’abord pour la foi. Commune à tous les hommes et obscure, disent-ils,, fut la forme primitive de la foi: parce que précisément elle prit naissance dans la nature même et dans la vie de l’homme. Ensuite elle progressa, et ce fut par évolution vitale, c’est-à-dire non pas par adjonction de nouvelles formes venues du dehors et purement adventices, mais par pénétration croissante du sentiment religieux dans la conscience. Et ce progrès fut de deux sortes: négatif, par élimination de tout élément étranger, tel que le sentiment familial ou national; positif, par solidarité avec le perfectionnement intellectuel et moral de l’homme, ce perfectionnement ayant pour effet d’élargir et d’éclairer de plus en plus la notion du divin, en même temps que d’élever et d’affiner le sentiment religieux.
Pour expliquer ce progrès de la foi, il n’y a pas à recourir à d’autres causes qu’à celles-là mêmes qui lui donnèrent origine, si ce n’est qu’il faut y ajouter l’action de certains hommes extraordinaires, ceux que nous appelons prophètes, et dont le plus illustre a été Jésus-Christ. Ils concourent au progrès de la foi soit parce qu’ils offrent dans leur vie et dans leur discours quelque chose de mystérieux dont la foi s’empare et qu’elle finit par attribuer à la divinité, soit parce qu’ils sont favorisés d’expériences originales, en harmonie avec les besoins des temps où ils vivent. Le progrès du dogme est dû surtout aux obstacles que la foi doit surmonter, aux ennemis qu’elle doit vaincre, aux contradictions qu’elle doit écarter. Ajoutez-y un effort perpétuel pour pénétrer toujours plus profondément ses propres mystères.
Ainsi est-il arrivé, pour nous borner à un seul exemple que, ce quelque chose de divin que la foi reconnaissait en Jésus-Christ, elle est allée l’élevant et l’élargissant peu à peu et par degrés, jusqu’à ce que de lui finalement elle a fait un Dieu. Le facteur principal de l’évolution du culte est la nécessité d’adaptation aux coutumes et traditions populaires, comme aussi le besoin de mettre à profit la valeur que certains actes tirent de l’accoutumance. Pour l’Eglise enfin, c’est le besoin de se plier aux conjonctures historiques, de s’harmoniser avec les formes existantes des sociétés civiles.
34. Telle est l’évolution dans le détail.
35. Ce que Nous voulons y faire noter d’une façon toute spéciale, c’est la théorie des nécessités ou besoins; elle a d’ailleurs été jusqu’ici la base de tout; et c’est là-dessus que portera cette fameuse méthode qu’ils appellent historique.
36. Nous n’en avons pas fini avec l’évolution. L’évolution est due, sans doute, à ces stimulants, les besoins; mais sous leur seule action, entraînée hors de la ligne traditionnelle, en rupture avec le germe initial, elle conduirait à la ruine plutôt qu’au progrès.
Disons donc, pour rendre pleinement la pensée des modernistes, que l’évolution résulte du conflit de deux forces, dont l’une pousse au progrès, tandis que l’autre tend à la conservation.
La force conservatrice, dans l’Eglise, c’est la tradition, et la tradition y est représentée par l’autorité religieuse. Ceci, et en droit et en fait: en droit, parce que la défense de la tradition est comme un instinct naturel de l’autorité; en fait, parce que, planant au-dessus des contingences de la vie, l’autorité ne sent pas, ou que très peu, les stimulants du progrès. La force progressive, au contraire, qui est celle qui répond aux besoins, couve et fermente dans les consciences individuelles, et dans celles-là surtout qui sont en contact plus intime avec la vie. Voyez-vous poindre ici, Vénérables Frères, cette doctrine pernicieuse qui veut faire des laïques, dans l’Eglise, un facteur de progrès? Or, c’est en vertu d’une sorte de compromis et de transaction entre la force conservatrice et la force progressive que les changements et les progrès se réalisent. Il arrive que les consciences individuelles, certaines du moins, réagissent sur la conscience collective: celle-ci, à son tour, fait pression sur les dépositaires de l’autorité jusqu’à ce qu’enfin ils viennent à composition ; et, le pacte fait, elle veille à son maintien.
37. On comprend maintenant l’étonnement des modernistes quand ils sont réprimandés et frappés. Ce qu’on leur reproche comme une faute, mais c’est ce qu’ils regardent au contraire comme un devoir sacré. En contact intime avec les consciences, mieux que personne, sûrement mieux que l’autorité ecclésiastique, ils en connaissent les besoins: ils les incarnent, pour ainsi dire, en eux. Dès lors, ayant une parole et une plume, ils en usent publiquement, c’est un devoir. Que l’autorité les réprimande tant qu’il lui plaira : ils ont pour eux leur conscience et une expérience intime qui leur dit avec certitude que ce qu’on leur doit, ce sont des louanges, non des reproches. Puis ils réfléchissent que, après tout, les progrès ne vont pas sans crises, ni les crises sans victimes. Victimes, soit ! ils le seront après les prophètes, après Jésus-Christ. Contre l’autorité qui les maltraite ils n’ont point d’amertume : après tout, elle fait son devoir d’autorité. Seulement ils déplorent qu’elle reste sourde à leurs objurgations, parce qu’en attendant, les obstacles se multiplient devant les âmes en marche vers l’idéal. Mais l’heure viendra, elle viendra sûrement, où il faudra ne plus tergiverser, parce qu’on peut bien contrarier l’évolution, on ne la force pas. Et ils vont leur route : réprimandés et condamnés, ils vont toujours, dissimulant sous des dehors menteurs de soumission une audace sans bornes. Ils courbent hypocritement la tête, pendant que, de toutes leurs pensées, de toutes leurs énergies, ils poursuivent plus audacieusement que jamais le plan tracé.
Ceci est chez eux une volonté et une tactique: et parce qu’ils tiennent qu’il faut stimuler l’autorité, non la détruire ; et parce qu’il leur importe de rester au sein de l’Eglise pour y travailler et y modifier peu à peu la conscience commune: avouant par là, mais sans s’en apercevoir, que la conscience commune n’est donc pas avec eux, et que c’est contre tout droit qu’ils s’en prétendent les interprètes.
38. Ainsi, Vénérables Frères, la doctrine des modernistes, comme l’objet de leurs efforts, c’est qu’il n’y ait rien de stable, rien d’immuable dans l’Église. Ils ont eu des précurseurs, ceux dont Pie IX, Notre prédécesseur, écrivait: Ces ennemis de la révélation divine exaltent le progrès humain et prétendent, avec une témérité et une audace vraiment sacrilèges, l’introduire dans la religion catholique, comme si cette religion n’était pas l’oeuvre de Dieu, mais l’oeuvre des hommes, une invention philosophique quelconque, susceptible de perfectionnements humains (14). Sur la révélation et le dogme, en particulier, la doctrine des modernistes n’offre rien de nouveau: nous la trouvons condamnée dans le Syllabus de Pie IX, où elle est énoncée en ces termes: La révélation divine est imparfaite, sujette par conséquent à un progrès continu et indéfini, en rapport avec le progrès de la raison humaine (15); plus solennellement encore, dans le Concile du Vatican. La doctrine de loi que Dieu a révélée n’a pas été proposée aux intelligences comme une intention philosophique qu’elles eussent à perfectionner, mais elle a été confiée comme un dépôt divin à l’Epouse de Jésus-Christ pour être par elle fidèlement gardée et infailliblement interprétée. C’est pourquoi aussi le sens des dogmes doit être retenu tel que notre Sainte Mère l’Eglise l’a une fois défini, et il ne faut jamais s’écarter de ce sens, sous le prétexte et le nom d’une plus profonde intelligence (16). Par là, et même en matière de foi, le développement de nos connaissances, loin d’être contrarié, est secondé au contraire et favorisé. C’est pourquoi le Concile du Vatican poursuit: Que l’intelligence, que la science, que la sagesse croisse et progresse, d’un mouvement vigoureux et intense, en chacun comme en tous, dans le fidèle comme dans toute l’Eglise, d’âge en âge, de siècle en siècle: mais seulement dans son genre, c’est-à-dire selon le même dogme, le même sens, la même acception (17).
39. Après avoir étudié chez les modernistes le philosophe, le croyant, le théologien, il Nous reste à considérer l’historien, le critique, l’apologiste, le réformateur.
40. Certains d’entre les modernistes, adonnés aux études historiques, paraissent redouter très fort qu’on les prenne pour des philosophes; de philosophie ils n’en savent pas le premier mot. Astuce profonde. Ce qu’ils craignent, c’est qu’on ne les soupçonne d’apporter en histoire des idées toutes faites, de provenance philosophique, qu’on ne les tienne pas pour assez objectifs, comme on dit aujourd’hui. Et pourtant, que leur histoire, que leur critique soient pure oeuvre de philosophie, que leurs conclusions historico-critiques viennent en droite ligne de leurs principes philosophiques, rien de plus facile à démontrer.
Leurs trois premières lois sont contenues dans trois principes philosophiques déjà vus : savoir, le principe de l’agnosticisme, le principe de la transfiguration des choses par la foi, le principe, enfin, que Nous avons cru pouvoir nommer de défiguration. De par l’agnosticisme, l’histoire, non plus que la science, ne roule que sur des phénomènes. Conclusion: Dieu, toute intervention de Dieu dans les choses humaines, doivent être renvoyées à la foi, comme de son ressort exclusif. Que s’il se présente une chose où le divin et l’humain se mélangent, Jésus-Christ, par exemple, l’Eglise, les sacrements, il y aura donc à scinder ce composé et à en dissocier les éléments: l’humain restera à l’histoire, le divin ira à la foi. De là, fort courante chez les modernistes, la distinction du Christ de l’histoire et du Christ de la foi, de l’Eglise de l’histoire et de l’Eglise de la foi, des sacrements de l’histoire et des sacrements de la foi, et ainsi de suite. Puis, tel qu’il apparaît dans les documents, cet élément humain retenu pour l’histoire a été lui-même transfiguré manifestement par la foi, c’est-à-dire élevé au-dessus des conditions historiques. Il faut donc en éliminer encore toutes les adjonctions que la foi y a faites, et les renvoyer à la foi elle-même et à l’histoire de la foi; ainsi, en ce qui regarde Jésus-Christ: tout ce qui dépasse l’homme selon sa condition naturelle et selon la conception que s’en fait la psychologie, l’homme aussi de telle région et de telle époque. Enfin, au nom du troisième principe philosophique, les choses mêmes qui ne dépassent pas la sphère historique sont passées au crible: tout ce qui, au jugement des modernistes, n’est pas dans la logique des faits, comme ils disent, tout ce qui n’est pas assorti aux personnes, est encore écarté de l’histoire et renvoyé à la foi. Ainsi ils prétendent que notre Seigneur n’a jamais proféré de parole qui ne pût être comprise des multitudes qui l’environnaient. D’où ils infèrent que toutes les allégories que l’on rencontre dans ses discours doivent être rayées de son histoire réelle, et transférées à la foi. Demande-t-on peut-être au nom de quel critérium s’opèrent de tels discernements ? Mais c’est en étudiant le caractère de l’homme, sa condition sociale, son éducation, l’ensemble des circonstances où se déroulent ses actes: toutes choses, si Nous l’entendons bien, qui se résolvent en un critérium purement subjectif. Car voici le procédé: ils cherchent à se revêtir de la personnalité de Jésus-Christ, puis tout ce qu’ils eussent fait eux-mêmes en semblables conjonctures, ils n’hésitent pas à le lui attribuer. Ainsi, absolument a priori, et au nom de certains principes philosophiques qu’ils affectent d’ignorer mais qui sont les bases de leur système, ils dénient au Christ de l’histoire réelle la divinité, comme à ses actes tout caractère divin; quant à l’homme, il n’a fait ni dit que ce qu’ils lui permettent, eux, en se reportant aux temps où il a vécu, de faire ou de dire.
41. Or, de même que l’histoire reçoit de la philosophie ses conclusions toutes faites, ainsi de l’histoire, la critique. En effet, sur les données fournies par l’historien, le critique fait deux parts dans les documents. Ceux qui répondent à la triple élimination vont à l’histoire de la foi ou à l’histoire intérieure; le résidu reste à l’histoire réelle. Car ils distinguent soigneusement cette double histoire ; et ce qui est à noter, c’est que l’histoire de la foi, ils l’opposent à l’histoire réelle, précisément en tant que réelle: d’où il suit que des deux Christs que Nous avons mentionnés, l’un est réel; l’autre, celui de la foi, n’a jamais existé dans la réalité; l’un a vécu en un point du temps et de l’espace, l’autre n’a jamais vécu ailleurs que dans les pieuses méditations du croyant. Tel, par exemple, le Christ que nous offre l’Evangile de saint Jean: cet Evangile n’est, d’un bout à l’autre, qu’une pure contemplation.
42. Là ne se borne pas la tutelle exercée par la philosophie sur l’histoire. Les documents partagés en deux lots, commue il a été dit, voici reparaître le philosophe avec son principe de l’immanence vitale. L’immanence vitale, déclare-t-il, est ce qui explique tout dans l’histoire de l’Eglise, et puisque la cause ou condition de toute émanation vitale réside dans quelque besoin, il s’ensuit que nul fait n’anticipe sur le besoin correspondant ; historiquement, il ne peut que lui être postérieur. Là-dessus, voici comment l’historien opère.
S’aidant des documents qu’il peut recueillir, contenus dans les Livres Saints ou pris d’ailleurs, il dresse une sorte de nomenclature des besoins successifs par où est passée l’Eglise; et une fois dressée, il la remet au critique. Celui-ci la recevant d’une main, prenant, de l’autre, le lot de documents assignés à l’histoire de la foi, échelonne ceux-ci le long des âges, dans un ordre et à des époques qui répondent exactement à celle-là, guidé par ce principe que la narration ne peut que suivre le fait, comme le fait, le besoin. Il est vrai, d’ailleurs, que certaines parties des Livres Saints, les Epîtres, par exemple, constituent le fait même créé par le besoin. Mais, quoi qu’il en soit, c’est une loi que la date des documents ne saurait autrement se déterminer que par la date des besoins auxquels successivement l’Eglise a été sujette.
Suit une autre opération, car il y a à distinguer entre l’origine d’un fait et son développement : ce qui naît en un jour ne prend des accroissements qu’avec le temps.
Le critique reviendra donc aux documents échelonnés déjà par lui à travers les âges, et en fera encore deux parts, l’une se rapportant à l’origine, l’autre au développement. Puis, la dernière, il la répartira à diverses époques, dans un ordre déterminé.
43. Le principe qui le dirigera dans cette opération lui sera fourni, une fois de plus, par le philosophe. Car, d’après le philosophe, une loi domine et régit l’histoire, c’est l’évolution. A l’historien donc de scruter à nouveau les documents, d’y rechercher attentivement les conjonctures ou conditions que l’Église a traversées au cours de sa vie, d’évaluer sa force conservatrice, les nécessités intérieures et extérieures qui l’ont stimulée au progrès, les obstacles qui ont essayé de lui barrer la route, en un mot, tout ce qui peut renseigner sur la manière dont se sont appliquées en elle les lois de l’évolution. Cela fait, et comme conclusion de cette étude, il trace une sorte d’esquisse de l’histoire de l’Eglise; le critique y adapte son dernier lot de documents, la plume court, l’histoire est écrite. Nous demandons : qui en sera dit l’auteur? L’historien? Le critique? A coup sûr ni l’un ni l’autre, mais bien le philosophe. Du commencement à la fin, n’est-ce pas l’a priori? Sans contredit, et un a priori où l’hérésie foisonne. Ces hommes-là nous font véritablement compassion; d’eux l’Apôtre dirait: Ils se sont évanouis dans leurs pensées…: se disant sages, ils sont tombés en démence (18). Mais où ils soulèvent le coeur d’indignation, c’est quand ils accusent l’Eglise de torturer les textes, de les arranger et de les amalgamer à sa guise pour les besoins de sa cause. Simplement, ils attribuent à l’Eglise ce qu’ils doivent sentir que leur reproche très nettement leur conscience.
44. De cet échelonnement, de cet éparpillement le long des siècles, il suit tout naturellement que les Livres Saints ne sauraient plus être attribués aux auteurs dont ils portent le nom.
Qu’à cela ne tienne! Ils n’hésitent pas à affirmer couramment que les livres en question, surtout le Pentateuque et les trois premiers Evangiles, se sont formés lentement d’adjonctions faites à une narration primitive fort brève: interpolations par manière d’interprétations théologiques ou allégoriques, ou simplement transitions et sutures.
C’est que, pour dire la chose d’un mot, il y a à reconnaître dans les Livres Sacrés une évolution vitale, parallèle et même conséquente à l’évolution de la foi.
Aussi bien, ajoutent-ils, les traces de cette évolution y sont si visibles qu’on en pourrait quasiment écrire l’histoire.
Ils l’écrivent, cette histoire, et si imperturbablement que vous diriez qu’ils ont vu de leurs yeux les écrivains à l’oeuvre, alors que, le long des âges, ils travaillaient à amplifier les Livres Saints.
45. La critique textuelle vient à la rescousse: pour confirmer cette histoire du texte sacré, ils s’évertuent à montrer que tel fait, que telle parole n’y est point à sa place, ajoutant d’autres critiques du même acabit. Vous croiriez, en vérité, qu’ils se sont construit certains types de narrations et de discours sur lesquels ils jugent ce qui est ou ce qui n’est pas déplacé. Et combien ils sont aptes à ce genre de critique! A les entendre vous parler de leurs travaux sur les Livres Sacrés, grâce auxquels ils ont pu découvrir en ceux-ci tant de choses défectueuses, il semblerait vraiment que nul homme avant eux ne les a feuilletés, qu’il n’y a pas eu à les fouiller en tous sens une multitude de docteurs infiniment supérieurs à eux en génie, en érudition, en sainteté; lesquels docteurs, bien loin d’y trouver à redire, redoublaient au contraire, à mesure qu’ils les scrutaient plus profondément, d’actions de grâce à la bonté divine, qui avait daigné de la sorte parler aux hommes. C’est que, malheureusement, ils n’avaient pas les mêmes auxiliaires d’études que les modernistes, savoir, comme guide et règle, une philosophie venue de l’agnosticisme, et comme critérium eux-mêmes. Il Nous semble avoir exposé assez clairement la méthode historique des modernistes. Le philosophe ouvre la marche ; suit l’historien ; puis, par ordre, la critique interne et la critique textuelle. Et comme le propre de la cause première est de laisser sa vertu dans tout ce qui suit, il est de toute évidence que nous ne sommes pas ici en face d’une critique quelconque, mais bien agnostique, immanentiste, évolutionniste. C’est pourquoi quiconque l’embrasse et l’emploie fait profession par là même d’accepter les erreurs qui y sont impliquées et se met en opposition avec la foi catholique.
46. S’il en est ainsi, on ne peut être qu’étrangement surpris de la valeur que lui prêtent certains catholiques. A cela il y a deux causes: d’une part, l’alliance étroite qu’ont faite entre eux les historiens et les critiques de cette école, au-dessus de toutes les diversités de nationalité et de religion; d’autre part, chez ces mêmes hommes, une audace sans bornes : que l’un d’entre eux ouvre les lèvres, les autres d’une même voix l’applaudissent, en criant au progrès de la science; quelqu’un a-t-il le malheur de critiquer l’une ou l’autre de leurs nouveautés, pour monstrueuse qu’elle soit, en rangs serrés, ils fondent sur lui; qui la nie est traité d’ignorant, qui l’embrasse et la défend est porté aux nues. Abusés par là, beaucoup vont à ceux qui, s’ils se rendaient compte des choses, reculeraient d’horreur.
A la faveur de l’audace et de la prépotence des uns, de la légèreté et de l’imprudence des autres, il s’est formé comme une atmosphère pestilentielle qui gagne tout, pénètre tout et propage la contagion.
Passons à l’apologiste.
47. L’apologiste, chez les modernistes, relève encore du philosophe, et à double titre.
D’abord, indirectement, en ce que, pour thème, il prend l’histoire, dictée, comme Nous l’avons vu, par le philosophe. Puis, directement, en ce qu’il emprunte de lui ses lois. De là cette affirmation courante chez les modernistes que la nouvelle apologétique doit s’alimenter aux sources psychologiques et historiques. Donc les modernes apologistes entrent en matière en avertissant les rationalistes que s’ils défendent la religion, ce n’est pas sur les données des Livres Saints ni sur les histoires qui ont cours dans l’Eglise, écrites sous l’inspiration des vieilles méthodes; mais sur une histoire réelle, rédigée à la lumière des principes modernes, et selon toute la rigueur des méthodes modernes. Et ce n’est pas par manière d’argumentation ad hominem qu’ils parlent ainsi; nullement, mais parce qu’ils tiennent, en effet, cette dernière histoire pour la seule vraie.
Qu’ils se tranquillisent! Les rationalistes les savent sincères: ne les connaissent-ils pas bien pour les avoir vus combattre à leurs côtés, sous le même drapeau? Et ces louanges qu’ils leur décernent, n’est-ce pas un salaire? louanges qui feraient horreur à un vrai catholique, mais dont eux, les modernistes, se félicitent et qu’ils opposent aux réprimandes de l’Eglise.
48. Mais voyons leurs procédés apologétiques. La fin qu’ils se proposent c’est d’amener le non-croyant à faire l’expérience de la religion catholique, expérience qui est, d’après leurs principes, le seul vrai fondement de la foi.
Deux voies y aboutissent: l’une objective, l’autre subjective. La première procède de l’agnosticisme. Elle tend à faire la preuve que la religion catholique, celle-là surtout, est douée d’une telle vitalité que son histoire, pour tout psychologue et pour tout historien de bonne foi, cache une inconnue. En cette vue, il est nécessaire de démontrer que cette religion, telle qu’elle existe aujourd’hui, est bien la même qui fut fondée par Jésus-Christ, c’est-à-dire le produit d’un développement progressif du germe qu’il apporta au monde. Ce germe, il s’agit donc, avant tout, de le bien déterminer ; et ils prétendent le faire par la formule suivante : Le Christ a annoncé l’avènement du royaume de Dieu comme devant se réaliser à brève échéance, royaume dont il devait être lui-même, de par la volonté divine, l’agent et l’ordonnateur. Puis on doit montrer comment ce germe, toujours immanent et permanent au sein de la religion catholique, est allé se développant lentement au cours de l’histoire, s’adaptant successivement aux divers milieux qu’il traversait, empruntant d’eux, par assimilation vitale, toutes les formes dogmatiques, cultuelles, ecclésiastiques qui pouvaient lui convenir; tandis que, d’autre part, il surmontait tous les obstacles, terrassait tous les ennemis, survivant à toutes les attaques et à tous les combats. Quiconque aura bien et dûment considéré tout cet ensemble d’obstacles, d’adversaires, d’attaques, de combats, ainsi que la vitalité et la fécondité qu’y affirme l’Eglise, devra reconnaître que, si les lois de l’évolution sont visibles dans sa vie, elles n’expliquent pas, néanmoins, le tout de son histoire, qu’une inconnue s’en dégage, qui se dresse devant l’esprit. Ainsi raisonnent-ils, sans s’apercevoir que la détermination du germe primitif est un a priori du philosophe agnostique et évolutionniste, et que la formule en est gratuite, créée pour les besoins de la cause.
49. Tout en s’efforçant, par de telles argumentations, d’ouvrir accès dans les âmes à la religion catholique, les nouveaux apologistes concèdent d’ailleurs bien volontiers qu’il s’y rencontre nombre de choses dont on pourrait s’offenser.
Ils vont même, et non sans une sorte de plaisir mal dissimulé, jusqu’à proclamer hautement que le dogme – ils l’ont constaté – n’est pas exempt d’erreurs et de contradictions. Ils ajoutent aussitôt, il est vrai, que tout cela est non seulement excusable, mais encore – étrange chose, en vérité! – juste et légitime. Dans les Livres Sacrés, il y a maints endroits touchant à la science ou à l’histoire, où se constatent des erreurs manifestes.
Mais ce n’est pas d’histoire ni de science que ces livres traitent; c’est uniquement de religion et de morale. L’histoire et la science n’y sont que des sortes d’involucres, où les expériences religieuses et morales s’enveloppent, pour pénétrer plus facilement dans les masses. Si, en effet, les masses n’entendaient pas autrement les choses, il est clair qu’une science et une histoire plus parfaites eussent été d’obstacle plutôt que de secours.
Au surplus, les Livres Saints, étant essentiellement religieux, sont par là même nécessairement vivants. Or, la vie a sa vérité et sa logique propres, bien différentes de la vérité et de la logique rationnelles, d’un autre ordre, savoir, vérité d’adaptation et de proportion soit avec le milieu où se déroule la vie, soit avec la fin où elle tend.
Enfin, ils poussent si loin les choses que, perdant toute mesure, ils en viennent à déclarer ce qui s’explique par la vie vrai et légitime. Nous, Vénérables Frères, pour qui il n’existe qu’une seule et unique vérité, et qui tenons que les Saints Livres, écrits sous l’inspiration du Saint-Esprit, ont Dieu pour auteur (19), Nous affirmons que cela équivaut à prêter à Dieu lui-même le mensonge d’utilité ou mensonge officieux, et Nous disons avec saint Augustin: En une autorité si haute, admettez un seul mensonge officieux, il ne restera plus parcelle de ces Livres, dès qu’elle paraîtra difficile ou à pratiquer ou à croire, dans laquelle il ne soit loisible de voir un mensonge de l’auteur, voulu à dessein en vue d’un but (20). Et ainsi il arrivera, poursuit le saint Docteur, que chacun croira ce qu’il voudra, ne croira pas ce qu’il ne voudra pas. Mais les nouveaux apologistes vont de l’avant, fort allègrement. Ils accordent encore que, dans les Saints Livres, certains raisonnements, allégués pour justifier telle ou telle doctrine, ne reposent sur aucun fondement rationnel, ceux, par exemple, qui s’appuient sur les prophéties. Ils ne sont d’ailleurs nullement embarrassés pour les défendre: artifices de prédication, disent-ils, légitimés par la vie.
50. Quoi encore? En ce qui regarde Jésus-Christ, ils reconnaissent, bien plus ils affirment qu’il a erré manifestement dans la détermination du temps où l’avènement du royaume de Dieu devait se réaliser. Aussi bien, quoi d’étonnant, s’il était lui-même tributaire des lois de la vie! Après cela, que ne diront-ils pas des dogmes de l’Eglise! Les dogmes! ils foisonnent de contradictions flagrantes ; mais, sans compter que la logique vitale les accepte, la vérité symbolique n’y répugne pas: est-ce qu’il ne s’agit pas de l’infini et est-ce que l’infini n’a pas d’infinis aspects? Enfin, ils tiennent tant et si bien à soutenir et à défendre les contradictions, qu’ils ne reculent pas devant cette déclaration, que le plus bel hommage à rendre à l’Infini, c’est encore d’en faire l’objet de propositions contradictoires. En vérité, quand on a légitimé la contradiction, y a-t-il quelque chose que l’on ne puisse légitimer?
51. Ce n’est pas seulement par des raisonnements objectifs que le non-croyant peut être disposé à la foi, mais encore par des arguments subjectifs. En cette vue, les modernistes, revenant à la doctrine de l’immanence, s’efforcent de persuader à cet homme que, en lui, dans les profondeurs mêmes de sa nature et de sa vie, se cachent l’exigence et le désir d’une religion, non point d’une religion quelconque, mais de cette religion spécifique qui est le catholicisme, absolument postulée, disent-ils, par le plein épanouissement de la vie.
Ici, Nous ne pouvons Nous empêcher de déplorer, une fois encore et très vivement, qu’il se rencontre des catholiques qui, répudiant l’immanence comme doctrine, l’emploient néanmoins comme méthode d’apologétique; qui le font, disons-Nous, avec si peu de retenue qu’ils paraissent admettre dans la nature humaine, au regard de l’ordre surnaturel, non pas seulement une capacité et une convenance – choses que, de tout temps, les apologistes catholiques ont eu soin de mettre en relief – mais une vraie et rigoureuse exigence.
A vrai dire, ceux des modernistes qui recourent ainsi à une exigence de la religion catholique sont les modérés.
Quant aux autres, que l’on peut appeler intégralistes, ce qu’ils se font forts de montrer au non-croyant, caché au fond de son être, c’est le germe même que Jésus-Christ porta dans sa conscience et qu’il a légué au monde.
Telle est, Vénérables Frères, rapidement esquissée, la méthode apologétique des modernistes, en parfaite concordance, on le voit, avec leurs doctrines, méthode et doctrines semées d’erreurs, faites non pour édifier mais pour détruire, non pour susciter des catholiques mais pour précipiter les catholiques à l’hérésie, mortelles même à toute religion.
52. Il Nous reste à dire quelques mots du réformateur.
Déjà, par tout ce que Nous avons exposé jusqu’ici, on a pu se faire une idée de la manie réformatrice qui possède les modernistes; rien, absolument rien, dans le catholicisme, à quoi elle ne s’attaque. Réforme de la philosophie, surtout dans les Séminaires: que l’on relègue la philosophie scolastique dans l’histoire de la philosophie, parmi les systèmes périmés, et que l’on enseigne aux jeunes gens la philosophie moderne, la seule vraie, la seule qui convienne à nos temps. Réforme de la théologie: que la théologie dite rationnelle ait pour base la philosophie moderne, la théologie positive pour fondement de l’histoire des dogmes. Quant à l’histoire, qu’elle ne soit plus écrite ni enseignée que selon leurs méthodes et leurs principes modernes. Que les dogmes et la notion de leur évolution soient harmonisés avec la science et l’histoire. Que dans les catéchismes on n’insère plus, en fait de dogmes, que ceux qui auront été réformés et qui seront à la portée du vulgaire. En ce qui regarde le culte, que l’on diminue le nombre des dévotions extérieures, ou tout au moins qu’on en arrête l’accroissement. Il est vrai de dire que certains, par un bel amour du symbolisme, se montrent assez coulants sur cette matière. Que le gouvernement ecclésiastique soit réformé dans toutes ses branches, surtout la disciplinaire et la dogmatique. Que son esprit, que ses procédés extérieurs soient mis en harmonie avec la conscience, qui tourne à la démocratie; qu’une part soit donc faite dans le gouvernement au clergé inférieur et même aux laïques; que l’autorité soit décentralisée. Réforme des Congrégations romaines, surtout de celles du Saint-Office et de l’Index. Que le pouvoir ecclésiastique change de ligne de conduite sur le terrain social et politique ; se tenant en dehors des organisations politiques et sociales, qu’il s’y adapte néanmoins pour les pénétrer de son esprit.
En morale, ils font leur le principe des américanistes, que les vertus actives doivent aller avant les passives, dans l’estimation que l’on en fait comme dans la pratique. Au clergé ils demandent de revenir à l’humilité et à la pauvreté antiques, et, quant à ses idées et son action, de les régler sur leurs principes.
Il en est enfin qui, faisant écho à leurs maîtres protestants, désirent la suppression du célibat ecclésiastique.
Que reste-t-il donc sur quoi, et par application de leurs principes, ils ne demandent réforme?
53. Quelqu’un pensera peut-être, Vénérables Frères, que cette exposition des doctrines des modernistes Nous a retenu trop longtemps. Elle était pourtant nécessaire, soit pour parer à leur reproche coutumier, que Nous ignorerions leurs vraies idées, soit pour montrer que leur système ne consiste pas en théories éparses et sans lien, mais bien en un corps parfaitement organisé, dont les parties sont si bien solidaires entre elles qu’on n’en peut admettre une sans les admettre toutes. C’est pour cela aussi que Nous avons dû donner à cette exposition un tour quelque peu didactique, sans avoir peur de certains vocables barbares en usage chez eux. Maintenant, embrassant d’un seul regard tout le système, qui pourra s’étonner que Nous le définissions le rendez-vous de toutes les hérésies? Si quelqu’un s’était donné la tâche de recueillir toutes les erreurs qui furent jamais contre la foi et d’en concentrer la substance et comme le suc en une seule, véritablement il n’eût pas mieux réussi. Ce n’est pas encore assez dire: ils ne ruinent pas seulement la religion catholique, mais, comme Nous l’avons déjà insinué, toute religion.
Les rationalistes les applaudissent, et ils ont pour cela leurs bonnes raisons : les plus sincères, les plus francs saluent en eux leurs plus puissants auxiliaires.
51. Revenons, en effet, un moment, Vénérables Frères, à cette doctrine pernicieuse de l’agnosticisme. Toute issue fermée vers Dieu du côté de l’intelligence, ils se font forts d’en ouvrir une autre du côté du sentiment et de l’action. Tentative vaine. Car qu’est-ce, après tout, que le sentiment, sinon une réaction de l’âme à l’action de l’intelligence ou des sens? Ôtez l’intelligence: l’homme, déjà si enclin à suivre les sens, en deviendra l’esclave. Vaine tentative à un autre point de vue. Toutes ces fantaisies sur le sentiment religieux n’aboliront pas le sens commun. Or, ce que dit le sens commun, c’est que l’émotion et tout ce qui captive l’âme, loin de favoriser la découverte de la vérité, l’entravent. Nous parlons, bien entendu, de la vérité en soi : quant à cette autre vérité purement subjective, issue du sentiment et de l’action, si elle peut être bonne aux jongleries de mots, elle ne sert de rien à l’homme, à qui il importe surtout de savoir si, hors de lui, il existe un Dieu, entre les mains de qui il tombera un jour. Pour donner quelque assiette au sentiment, les modernistes recourent à l’expérience. Mais l’expérience, qu’y ajoute-t-elle? Absolument rien, sinon une certaine intensité qui entraîne une conviction proportionnée de la réalité de l’objet. Or, ces deux choses ne font pas que le sentiment ne soit sentiment, ils ne lui ôtent pas son caractère, qui est de décevoir si l’intelligence ne le guide ; au contraire, ce caractère, ils le confirment et l’aggravent, car plus le sentiment est intense et plus il est sentiment. En matière de sentiment religieux et d’expérience religieuse, vous n’ignorez pas, Vénérables Frères, quelle prudence est nécessaire, quelle science aussi qui dirige la prudence. Vous le savez de votre usage des âmes, de celles surtout où le sentiment domine; vous le savez aussi de la lecture des ouvrages ascétiques, ouvrages que les modernistes prisent fort peu, mais qui témoignent d’une science autrement solide que la leur, d’une sagacité d’observation autrement fine et subtile. En vérité, n’est-ce pas une folie, ou tout au moins une souveraine imprudence, de se fier sans nul contrôle à des expériences comme celles que prônent les modernistes?
55. Et qu’il Nous soit permis en passant de poser une question: Si ces expériences ont tant de valeur à leurs yeux, pourquoi ne la reconnaissent-ils pas à celle que des milliers et des milliers de catholiques déclarent avoir sur leur compte à eux et qui les convainc qu’ils font fausse route? Est-ce que, par hasard, ces dernières expériences seraient les seules fausses et trompeuses? La très grande majorité des hommes tient fermement et tiendra toujours que le sentiment et l’expérience seuls, sans être éclairés et guidés de la raison, ne conduisent pas à Dieu.
Que reste-t-il donc, sinon l’anéantissement de toute religion et l’athéisme? Ce n’est certes pas la doctrine du symbolisme qui pourra le conjurer. Car si tous les éléments, dans la religion, ne sont que de purs symboles de Dieu, pourquoi le nom même de Dieu, le nom de personnalité divine ne seraient-ils pas aussi de purs symboles? Cela admis, voilà la personnalité de Dieu mise en question et la voie ouverte au panthéisme. Au panthéisme, mais cette autre doctrine de l’immanence divine y conduit tout droit. Car Nous demandons si elle laisse Dieu distinct de l’homme ou non : si distinct, en quoi diffère-t-elle de la doctrine catholique et de quel droit rejeter la révélation extérieure ? Si non distinct, nous voilà en plein panthéisme. Or, la doctrine de l’immanence, au sens moderniste, tient et professe que tout phénomène de conscience est issu de l’homme en tant qu’homme. La conclusion rigoureuse c’est l’identité de l’homme et de Dieu, c’est-à-dire le panthéisme.
La même conclusion découle de la distinction qu’ils posent entre la science et la foi.
L’objet de la science, c’est la réalité du connaissable; l’objet de la foi, au contraire, la réalité de l’inconnaissable. Or, ce qui fait l’inconnaissable, c’est sa disproportion avec l’intelligence, disproportion que rien au monde, même dans la doctrine des modernistes, ne peut faire disparaître. Par conséquent, l’inconnaissable reste et restera éternellement inconnaissable, autant au croyant qu’à l’homme de la science. La religion d’une réalité inconnaissable, voilà donc la seule possible. Et pourquoi cette réalité ne serait-elle pas l’âme universelle du monde dont parle tel rationaliste, c’est ce que Nous ne voyons pas. Voilà qui suffit, et surabondamment, pour montrer par combien de routes le modernisme conduit à l’anéantissement de toute religion. Le premier pas fut fait par le protestantisme, le second est fait par le modernisme, le prochain précipitera dans l’athéisme.
56. Pour pénétrer mieux encore le modernisme et trouver plus sûrement à une plaie si profonde les remèdes convenables, il importe, Vénérables Frères, de rechercher les causes qui l’ont engendrée et qui l’alimentent.
57. La cause prochaine et immédiate réside dans une perversion de l’esprit, cela ne fait pas de doute. Les causes éloignées Nous paraissent pouvoir se réduire à deux: la curiosité et l’orgueil. La curiosité, à elle seule, si elle n’est sagement réglée, suffit à expliquer toutes les erreurs. C’est l’avis de Notre Prédécesseur Grégoire XVI, qui écrivait: C’est un spectacle lamentable que de voir jusqu’où vont les divagations de l’humaine raison dès que l’on cède à l’esprit de nouveauté que, contrairement à l’avertissement de l’Apôtre, l’on prétend à savoir plus qu’il ne faut savoir et que, se fiant trop à soi-même, l’on pense pouvoir chercher la vérité hors de l’Eglise, en qui elle se trouve sans l’ombre la plus légère d’erreur (21). Mais ce qui a incomparablement plus d’action sur l’âme, pour l’aveugler et la jeter dans le faux, c’est l’orgueil. L’orgueil! Il est, dans la doctrine des modernistes, comme chez lui ; de quelque côté qu’il s’y tourne, tout lui fournit un aliment, et il s’y étale sous toutes ses faces.
Orgueil, assurément, cette confiance en eux qui les fait s’ériger en règle universelle. Orgueil, cette vaine gloire qui les représente à leurs propres yeux comme les seuls détenteurs de la sagesse qui leur fait dire, hautains et enflés d’eux-mêmes: Nous ne sommes pas comme le reste des hommes et qui, afin qu’ils n’aient pas, en effet, de comparaison avec les autres, les pousse aux plus absurdes nouveautés. Orgueil, cet esprit d’insoumission qui appelle une conciliation de l’autorité avec la liberté. Orgueil, cette prétention de réformer les autres dans l’oubli d’eux-mêmes, ce manque absolu de respect à l’égard de l’autorité sans en excepter l’autorité suprême.
Non, en vérité, nulle route qui conduise plus droit ni plus vite au modernisme que l’orgueil. Qu’on nous donne un catholique laïque, qu’on nous donne un prêtre, qui ait perdu de vue le précepte fondamental de la vie chrétienne, savoir que nous devons nous renoncer nous-mêmes si nous voulons suivre Jésus-Christ et qui n’ait pas arraché l’orgueil de son cœur ; ce laïque, ce prêtre est mûr pour toutes les erreurs du modernisme. C’est pourquoi, Vénérables Frères, votre premier devoir est de traverser ces hommes superbes, et les appliquer à d’infimes et obscures fonctions; qu’ils soient mis d’autant plus bas qu’ils cherchent à monter plus haut et que leur abaissement même leur ôte la faculté de nuire.
De plus, sondez soigneusement par vous-mêmes ou par les directeurs de vos Séminaires les jeunes clercs; ceux chez qui vous aurez constaté l’esprit d’orgueil, écartez-les sans pitié du sacerdoce. Plût à Dieu qu’on en eût toujours usé de la sorte, avec la vigilance et la constance voulues!
58. Que si, des causes morales, Nous venons aux intellectuelles, la première qui se présente – et la principale – c’est l’ignorance. Oui, ces modernistes, qui jouent aux docteurs de l’Eglise, qui portent aux nues la philosophie moderne et regardent de si haut la scolastique, n’ont embrassé celle-là, en se laissant prendre à ses apparences fallacieuses, que parce que, ignorants de celle-ci, il leur a manqué l’instrument nécessaire pour percer les confusions et dissiper les sophismes.
Or, c’est d’une alliance de la fausse philosophie avec la foi qu’est né, pétri d’erreurs, leur système.
59. Si encore ils apportaient moins de zèle et d’activité à le propager! Mais telle est en cela leur ardeur, telle leur opiniâtreté de travail qu’on ne peut sans tristesse les voir dépenser à ruiner l’Eglise de si belles énergies, quand elles lui eussent été si profitables bien employées. Leurs artifices pour abuser les esprits sont de deux sortes : s’efforcer d’écarter les obstacles qui les traversent; puis rechercher avec soin, mettre activement et patiemment en oeuvre tout ce qui les peut servir.
Trois choses, ils le sentent bien, leur barrent la route : la philosophie scolastique, l’autorité des Pères et la tradition, le magistère de l’Eglise.
A ces trois choses ils font une guerre acharnée.
Ignorance ou crainte, à vrai dire l’une et l’autre, c’est un fait qu’avec l’amour des nouveautés va toujours de pair la haine de la méthode scolastique; et il n’est pas d’indice plus sûr que le goût des doctrines modernistes commence à poindre dans un esprit, que d’y voir naître le dégoût de cette méthode.
Que les modernistes et leurs fauteurs se souviennent de la proposition condamnée par Pie IX: La méthode et les principes qui ont servi aux antiques docteurs scolastiques, dans la culture de la théologie, ne répondent plus aux exigences de notre temps ni au progrès des sciences (22).
La tradition, ils s’efforcent d’en fausser perfidement le caractère et d’en saper l’autorité, afin de lui ôter toute valeur. Mais le second Concile de Nicée fera toujours loi pour les catholiques; il condamne ceux qui osent, sur les traces des hérétiques impies, mépriser les traditions ecclésiastiques, inventer quelque nouveauté… ou chercher, avec malice ou avec astuce, à renverser quoi que ce soit des légitimes traditions de l’Eglise catholique. Fera loi, de même, la profession du quatrième Concile de Constantinople: C’est pourquoi nous faisons profession de conserver et de garder les règles qui ont été léguées à la sainte Eglise catholique et apostolique, soit par les saints et très illustres Apôtres, soit par les Conciles orthodoxes, généraux et particuliers, et même par chacun des Pères interprètes divins et docteurs de l’Eglise. Aussi les papes Pie IV et Pie IX ont-ils ordonné l’insertion dans la profession de foi de la déclaration suivante: J’admets et j’embrasse très fermement les traditions apostoliques et ecclésiastiques, et toutes les autres observances et constitutions de l’Eglise. Naturellement, les modernistes étendent aux saints Pères le jugement qu’ils font de la tradition. Avec une audace inouïe, ils les déclarent personnellement dignes de toute vénération, mais d’ailleurs d’une ignorance incroyable en matière d’histoire et de critique et qui ne peut être excusée que par le temps où ils vécurent.
60. Enfin, ils s’évertuent à amoindrir le magistère ecclésiastique et à en infirmer l’autorité, soit en en dénaturant sacrilègement l’origine, le caractère, les droits, soit en rééditant contre lui, le plus librement du monde, les calomnies des adversaires. Au clan moderniste s’applique ce que Notre prédécesseur écrivait, la douleur dans l’âme: Afin d’attirer le mépris et l’odieux sur l’Epouse mystique du Christ, en qui est la vraie lumière, les fils des ténèbres ont accoutumé de lui jeter à la face des peuples une calomnie perfide, et, renversant la notion et la valeur des choses et des mots, la représentent comme amie des ténèbres, fautrice d’ignorance, ennemie de la lumière, de la science, du progrès (23). Après cela, il n’y a pas lieu de s’étonner si les modernistes poursuivent de toute leur malveillance, de toute leur acrimonie, les catholiques qui luttent vigoureusement pour l’Eglise.
Il n’est sorte d’injures qu’ils ne vomissent contre eux. Celle d’ignorance et d’entêtement est la préférée. S’agit-il d’un adversaire que son érudition et sa vigueur d’esprit rendent redoutable : ils chercheront à le réduire à l’impuissance en organisant autour de lui la conspiration du silence. Conduite d’autant plus blâmable que, dans le même temps, sans fin ni mesure, ils accablent d’éloges qui se met de leur bord. Un ouvrage paraît, respirant la nouveauté par tous ses pores ; ils l’accueillent avec des applaudissements et des cris d’admiration. Plus un auteur aura apporté d’audace à battre en brèche l’antiquité, à saper la tradition et le magistère ecclésiastique, et plus il sera savant. Enfin – et ceci est un sujet de véritable horreur pour les bons – s’il arrive que l’un d’entre eux soit frappé des condamnations de l’Eglise, les autres aussitôt de se presser autour de lui, de le combler d’éloges publics, de le vénérer presque comme un martyr de la vérité. Les jeunes, étourdis et troublés de tout ce fracas de louanges et d’injures, finissent, par peur du qualificatif d’ignorants et par ambition du titre de savants, en même temps que sous l’aiguillon intérieur de la curiosité et de l’orgueil, par céder au courant et se jeter dans le modernisme.
61. Mais ceci appartient déjà aux artifices employés par les modernistes pour leurs produits. Que ne mettent-ils pas en oeuvre pour se créer de nouveaux partisans! Ils s’emparent de chaires dans les Séminaires, dans les Universités, et les transforment en chaires de pestilence. Déguisées peut-être, ils sèment leurs doctrines de la chaire sacrée ; ils les professent ouvertement dans les Congrès; ils les font pénétrer et les mettent en vogue dans les institutions sociales. Sous leur propre nom, sous des pseudonymes, ils publient livres, journaux, revues. Le même multipliera ses pseudonymes, pour mieux tromper, par la multitude simulée des auteurs, le lecteur imprudent. En un mot, action, discours, écrits, il n’est rien qu’ils ne mettent en jeu, et véritablement vous les diriez saisis d’une sorte de frénésie. Le fruit de tout cela? Notre coeur se serre à voir tant de jeunes gens, qui étaient l’espoir de l’Église et à qui ils promettaient de si bons services, absolument dévoyés. Un autre spectacle encore Nous attriste: c’est que tant d’autres catholiques, n’allant certes pas aussi loin, aient pris néanmoins l’habitude, comme s’ils eussent respiré un air contaminé, de penser, parler, écrire avec plus de liberté qu’il ne convient à des catholiques. De ceux-ci, il en est parmi les laïques, il en est dans les rangs du clergé, et ils ne font pas défaut là où on devait moins les attendre, dans les Instituts religieux. S’ils traitent de questions bibliques, c’est d’après les principes modernistes. S’ils écrivent l’histoire, ils recherchent avec curiosité et publient au grand jour, sous couleur de dire toute la vérité et avec une sorte de plaisir mal dissimulé, tout ce qui leur paraît faire tache dans l’histoire de l’Eglise. Dominés par de certains a priori, ils détruisent, autant qu’ils le peuvent, les pieuses traditions populaires. Ils tournent en ridicule certaines reliques, fort vénérables par leur antiquité. Ils sont enfin possédés du vain désir de faire parler d’eux : ce qui n’arriverait pas, ils le comprennent bien, s’ils disaient comme on a toujours dit jusqu’ici. Peut-être en sont-ils venus à se persuader qu’en cela ils servent Dieu et l’Eglise: en réalité, ils les offensent, moins peut-être par leurs oeuvres mêmes que par l’esprit qui les anime et par le concours qu’ils prêtent aux audaces des modernistes.
62. A tant et de si graves erreurs, à leurs envahissements publics et occultes, Notre Prédécesseur Léon XIII, d’heureuse mémoire, chercha fortement à s’opposer, surtout en matière biblique, et par des paroles et par des actes. Mais ce ne sont pas armes, Nous l’avons dit, dont les modernistes s’effrayent facilement. Avec des airs affectés de soumission et de respect, les paroles, ils les plièrent à leur sentiment, les actes, ils les rapportèrent à tout autre qu’à eux-mêmes. Et le mal est allé s’aggravant de jour en jour. C’est pourquoi, Vénérables Frères, Nous sommes venu à la détermination de prendre sans autre retard des mesures plus efficaces.
Nous vous prions et vous conjurons de ne pas souffrir que l’on puisse trouver le moins du monde à redire, en une matière si grave, à votre vigilance, à votre zèle, à votre fermeté. Et ce que Nous vous demandons et que Nous attendons de vous, Nous le demandons aussi et l’attendons de tous les autres pasteurs d’âmes, et de tous les éducateurs et professeurs de la jeunesse cléricale, et tout spécialement des supérieurs majeurs des Instituts religieux.
63. Premièrement, en ce qui regarde les études, Nous voulons et ordonnons que la philosophie scolastique soit mise à la base des sciences sacrées. Il va sans dire que s’il se rencontre quelque chose chez les docteurs scolastiques que l’on puisse regarder comme excès de subtilité, ou qui ne cadre pas avec les découvertes des temps postérieurs, ou qui n’ait enfin aucune espèce de probabilité, il est bien loin de notre esprit de vouloir le proposer à l’imitation des générations présentes (24). Et quand Nous prescrivons la philosophie scolastique, ce que Nous entendons surtout par là – ceci est capital – c’est la philosophie que nous a léguée le Docteur angélique. Nous déclarons que tout ce qui a été édicté à ce sujet par Notre Prédécesseur reste pleinement en vigueur, et, en tant que de besoin, Nous l’édictons à nouveau et le confirmons, et ordonnons qu’il soit par tous rigoureusement observé. Que, dans les Séminaires où on aurait pu le mettre en oubli, les évêques en imposent et en exigent l’observance : prescriptions qui s’adressent aussi aux Supérieurs des Instituts religieux. Et que les professeurs sachent bien que s’écarter de saint Thomas, surtout dans les questions métaphysiques, ne va pas sans détriment grave.
64. Sur cette base philosophique, que l’on élève solidement l’édifice théologique. Autant que vous le pourrez, Vénérables Frères, stimulez à l’étude de la théologie, de façon que les clercs en emportent, au sortir du Séminaire, une estime profonde et un ardent amour, et que, toute leur vie, ils en fassent leurs délices. Car nul n’ignore que, parmi cette grande multitude de sciences, et si diverses, qui s’offrent à l’esprit avide de vérité, la première place revient de droit à la théologie, tellement que c’était une maxime de l’antique sagesse que le devoir des autres sciences, comme des arts, est de lui être assujetties et soumises à la manière des servantes (25). Ajoutons que ceux-là, entre autres, Nous paraissent dignes de louanges qui, pleinement respectueux de la tradition, des saints Pères, du magistère ecclésiastique, mesurés dans leurs jugements, et se guidant sur les normes catholiques (ce qui ne se voit pas chez tous), ont pris à tâche de faire plus de lumière dans la théologie positive, en y projetant celle de l’histoire – de la vraie. Evidemment, il faut donner plus d’importance que par le passé à la théologie positive, mais sans le moindre détriment pour la théologie scolastique; et ceux-là sont à réprimander, comme faisant les affaires des modernistes, qui exaltent de telle façon la théologie positive, qu’ils ont tout l’air de dénigrer en même temps la scolastique.
65. Quant aux études profanes, il suffira de rappeler ce qu’en a dit fort sagement Notre Prédécesseur: Appliquez-vous avec ardeur à l’étude des sciences naturelles: les géniales découvertes, les applications hardies et utiles faites de nos jours sur ce terrain, qui provoquent à juste titre les applaudissements des contemporains, seront aussi à la postérité un sujet d’admiration et de louanges (26). Mais les études sacrées n’en doivent pas souffrir. Sur quoi le même Pape donne tout aussitôt le grave avertissement que voici: Si l’on recherche avec soin la cause de ces erreurs, on la trouvera surtout en ceci : que plus s’est accrue l’ardeur pour les sciences naturelles, plus les hautes sciences, les sciences sévères sont allées déclinant; il en est qui languissent dans l’oubli; certaines autres sont traitées faiblement et à la légère, et, ce qui est indigne, déchues de leur antique splendeur, on les infecte encore de doctrines perverses et d’opinions dont la monstruosité épouvante (27). Sur cette loi, Nous ordonnons que l’on règle dans les Séminaires l’étude des sciences naturelles.
66. On devra avoir ces prescriptions, et celles de Notre Prédécesseur et les Nôtres, sous les yeux, chaque fois que l’on traitera du choix des directeurs et professeurs pour les Séminaires et les Universités catholiques. Qui, d’une manière ou d’une autre, se montre imbu de modernisme sera exclu, sans merci, de la charge de directeur ou de professeur; l’occupant déjà, il en sera retiré; de même, qui favorise le modernisme, soit en vantant les modernistes ou en excusant leur conduite coupable, soit en critiquant la scolastique, les saints Pères, le magistère de l’Eglise, soit en refusant obéissance à l’autorité ecclésiastique, quel qu’en soit le dépositaire; de même qui, en histoire, en archéologie, en exégèse biblique, trahit l’amour de la nouveauté; de même enfin, qui néglige les sciences sacrées ou paraît leur préférer les profanes. Dans toute cette question des études, Vénérables Frères, vous n’apporterez jamais trop de vigilance ni de constance, surtout dans le choix des professeurs: car, d’ordinaire, c’est sur le modèle des maîtres que se forment les élèves. Forts de la conscience de votre devoir, agissez en tout ceci prudemment, mais fortement.
67. Il faut procéder avec même vigilance et sévérité à l’examen et au choix des candidats aux saints Ordres. Loin, bien loin du sacerdoce l’esprit de nouveauté! Dieu hait les superbes et les opiniâtres. Que le doctorat en théologie et en droit canonique ne soit plus conféré désormais à quiconque n’aura pas suivi le cours régulier de philosophie scolastique; conféré, qu’il soit tenu pour nul et de nulle valeur. Les prescriptions faites par la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers, dans un décret de 1896, aux clercs séculiers et réguliers d’Italie, concernant la fréquentation des Universités, Nous en décrétons l’extension désormais à toutes les nations. Défense est faite aux clercs et aux prêtres qui ont pris quelque inscription dans une Université ou Institut catholique de suivre, pour les matières qui y sont professées, les cours des Universités civiles. Si cela a été permis quelque part, Nous l’interdisons pour l’avenir. Que les évêques qui président à la direction de ces Universités et Instituts veillent à ce que les prescriptions que Nous venons d’édicter y soient fidèlement observées.
68. Il est encore du devoir des évêques, en ce qui regarde les droits entachés de modernisme et propagateurs de modernisme, d’en empêcher la publication, et, publiés, d’en entraver la lecture. Que tous les livres, journaux, revues de cette nature, ne soient pas laissés aux mains des élèves, dans les Séminaires ou dans les Universités: ils ne sont pas, en effet, moins pernicieux que les écrits contre les bonnes moeurs, ils le sont même davantage, car ils empoisonnent la vie chrétienne dans sa source. Il n’y a pas à juger autrement certains ouvrages publiés par des catholiques, hommes dont on ne peut suspecter l’esprit, mais qui, dépourvus de connaissances théologiques et imbus de philosophie moderne, s’évertuent à concilier celle-ci avec la foi, et à l’utiliser, comme ils disent, au profit de la foi. Lus de confiance, à cause du nom et du bon renom des auteurs, ils ont pour effet, et c’est ce qui les rend plus dangereux, de faire glisser lentement vers le modernisme.
69. Généralement, Vénérables Frères, et c’est ici le point capital, faites tout au monde pour bannir de votre diocèse tout livre pernicieux, recourant, pour cela, s’il en est besoin, à l’interdiction solennelle. Le Saint-Siège ne néglige rien pour faire disparaître les écrits de cette nature; mais le nombre en est tel aujourd’hui que les censurer tous est au-dessus de ses forces. La conséquence, c’est que le remède vient quelquefois trop tard, alors que le mal a déjà fait ses ravages. Nous voulons donc que les Évêques, méprisant toute crainte humaine, foulant aux pieds toute prudence de la chair, sans égard aux criailleries des méchants, suavement, sans doute, mais fortement, prennent en ceci leur part de responsabilité, se souvenant des prescriptions de Léon XIII, dans la Constitution Apostolique Officiorum: Que les Ordinaires, même comme délégués du Siège Apostolique, s’efforcent de proscrire les livres et autres écrits mauvais, publiés ou répandus dans leurs diocèses, et de les arracher des mains des fidèles. C’est un droit qui est conféré dans ces paroles, mais aussi un devoir qui est imposé. Et que nul ne pense avoir satisfait aux obligations de sa charge s’il Nous a déféré un ou deux ouvrages et laissé les autres, en grand nombre, se répandre et circuler. Ne vous laissez pas arrêter, Vénérables Frères, au fait que l’auteur a pu obtenir d’ailleurs l’Imprimatur: cet Imprimatur peut être apocryphe, ou il a pu être accordé sur examen inattentif, ou encore par trop de bienveillance ou de confiance à l’égard de l’auteur, ce qui arrive peut-être quelquefois dans les Ordres religieux. Puis, le même aliment ne convient pas à tous : de même, un livre inoffensif dans un endroit peut, au contraire, à raison des circonstances, être fort nuisible dans un autre. Si donc l’Évêque, après avoir pris l’avis d’hommes prudents, juge nécessaire de censurer dans son diocèse quelque livre de ce genre, qu’il le fasse, Nous lui en donnons très volontiers la faculté, Nous lui en imposons même l’obligation. La chose, naturellement, doit se faire avec prudence, en restreignant la prohibition, si cela suffit, au clergé : restriction, en tout cas, que ne prendront jamais pour eux les libraires, dont c’est le devoir de retirer purement et simplement de la vente les ouvrages condamnés par l’évêque. Et puisqu’il est question des libraires, que les évêques veillent à ce que l’amour du lucre ne les entraîne pas à trafiquer de produits délétères. Il est de fait qu’en certains de leurs catalogues s’étalent, accompagnés de réclames alléchantes, bon nombre d’ouvrages modernistes. Que s’ils refusent obéissance, les évêques n’hésiteront pas, après monition, à les priver du titre de libraires catholiques; de même, et à plus forte raison, du titre de libraires épiscopaux, s’ils en ont été gratifiés. Quant aux libraires pontificaux, ils les déféreront au Saint-Siège. A tous Nous rappelons l’article XXVI de la Constitution Officiorum: Ceux qui ont obtenu la faculté de lire et retenir les livres prohibés n’ont pas pour cela le droit de lire et de retenir les livres ou journaux, quels qu’ils soient, interdits par l’Ordinaire, à moins que dans l’Indult apostolique la faculté ne leur ait été accordée expressément de lire et de retenir les livres condamnés par n’importe quelle autorité.
70. Il ne suffit pas d’empêcher la lecture et la vente des mauvais livres, il faut encore en entraver la publication. Que les évêques donc usent de la plus grande sévérité en accordant la permission de publier. Or, comme le nombre est grand, d’après la Constitution Officiorum, des ouvrages qui ne peuvent paraître sans la permission de l’Ordinaire, et comme, d’autre part, l’évêque ne les peut tous réviser par lui-même, dans certains diocèses on a institué, pour procéder à cette révision, des censeurs d’office. Nous louons très fort cette institution, et non seulement Nous engageons à l’étendre à tous les diocèses, mais Nous en faisons un précepte strict. Qu’il y ait donc dans toutes les curies épiscopales des censeurs d’office, chargés de l’examen des ouvrages à publier : ils seront choisis parmi les prêtres du clergé tant régulier que séculier, recommandables par leur âge, leur science, leur prudence, et qui, en matière de doctrine à approuver ou à blâmer, se tiennent dans le juste milieu. A eux sera déféré l’examen de tous les écrits, qui d’après les articles XLI et XLII de la Constitution mentionnées, ne peuvent être édités sans permission. Le censeur donnera son avis par écrit. Si cet avis est favorable, l’évêque délivrera le permis de publication, par ce mot Imprimatur, mais qui sera précédé de la formule Nihil obstat, avec, au-dessus, le nom du censeur. Dans la curie romaine, aussi bien que dans les autres, des censeurs seront institués. Leur nomination sera faite, d’entente avec le cardinal vicaire, et avec l’approbation du Souverain Pontife, par le maître du Sacré Palais. A celui-ci il appartiendra de désigner le censeur pour la révision de chaque ouvrage. Le permis de publication sera encore délivré par lui, ainsi que le cardinal vicaire ou son vice-gérant, et il sera précédé, comme ci-dessus, de la formule d’approbation du censeur, suivie de son nom. Seulement dans des cas exceptionnels et fort rares, pour des raisons dont l’appréciation est laissée à la prudence de l’évêque, la mention du censeur pourra être omise. Le nom du censeur sera tenu secret aux auteurs, et ne leur sera révélé qu’après avis favorable; de peur qu’il ne soit molesté, et durant le travail de révision et par la suite, s’il a refusé son approbation. Nul censeur ne sera pris dans un Institut religieux sans qu’on ait, au préalable, consulté secrètement le provincial, ou, s’il s’agit de Rome, le Supérieur général; celui-ci, provincial ou Supérieur général, devra attester en conscience la vertu, la science, l’intégrité doctrinale du candidat. Nous avertissons les Supérieurs religieux du grave devoir qui leur incombe de veiller à ce qu’aucun ouvrage ne soit publié sans leur autorisation et celle de l’Ordinaire. Nous déclarons enfin que le titre de censeur ne pourra jamais être invoqué pour appuyer les opinions personnelles de celui qui en aura été revêtu et sera, à cet égard, de nulle valeur.
71. Ceci dit en général, Nous ordonnons en particulier l’observation de l’article XLII de la Constitution Officiorum, dont voici la teneur: Défense aux membres du clergé tant séculier que régulier de prendre la direction de journaux ou de revues sans la permission des Ordinaires. Que s’ils viennent à abuser de cette permission, elle leur sera retirée, après monition. En ce qui regarde les prêtres correspondants ou collaborateurs – pour employer les mots courants – comme il n’est pas rare qu’ils glissent dans les journaux ou revues des articles entachés de modernisme, il appartient aux évêques de les surveiller, et, s’ils les prennent en faute, de les avertir d’abord, puis de leur interdire toute espèce de collaboration ou correspondance. Même injonction est faite aux supérieurs religieux : en cas de négligence de leur part, les évêques agiront comme délégués du Souverain Pontife. Qu’à chaque journal et revue il soit assigné, autant que faire se pourra, un censeur dont ce sera le devoir de parcourir en temps opportun chaque numéro publié, et, s’il y rencontre quelque idée dangereuse, d’en imposer au plus tôt la rétractation. Ce même droit appartiendra à l’évêque, lors même que l’avis du censeur aurait été favorable.
72. Nous avons déjà parlé des Congrès et assemblées publiques comme d’un champ propice aux modernistes pour y semer et y faire prévaloir leurs idées. Que désormais les évêques ne permettent plus, ou que très rarement, de Congrès sacerdotaux. Que s’il leur arrive d’en permettre, que ce soit toujours sous cette loi qu’on n’y traitera point de question relevant du Saint-Siège ou des évêques, que l’on n’y émettra aucune proposition ni aucun voeu usurpant sur l’autorité ecclésiastique, que l’on n’y proférera aucune parole qui sente le modernisme, ou le presbytérianisme, ou le laïcisme. – À ces sortes de Congrès, qui ne pourront se tenir que sur autorisation écrite, accordée en temps opportun, et particulière pour chaque cas, les prêtres des diocèses étrangers ne pourront intervenir sans une permission pareillement écrite de leur Ordinaire. Nul prêtre, au surplus, ne doit perdre de vue la grave recommandation de Léon XIII: Que l’autorité de leurs pasteurs soit sacrée aux prêtres, qu’ils tiennent pour certain que le ministère sacerdotal, s’il n’est exercé sous la conduite des évêques, ne peut être ni saint, ni fructueux, ni recommandable (Lettr. Enc. Nobilissima Gallorum, 10 févr. 1884).
73. Mais que servirait-il, Vénérables Frères, que Nous intimions des ordres, que Nous fassions des prescriptions, si on ne devait pas les observer ponctuellement et fidèlement? Afin que nos vues et nos voeux soient remplis, il Nous a paru bon d’étendre à tous les diocèses ce que les évêques de l’Ombrie, il y a déjà longtemps, établirent dans les leurs, avec beaucoup de sagesse. Afin, disaient-ils, de bannir les erreurs déjà répandues et d’en empêcher une diffusion plus grande, de faire disparaître aussi les docteurs de mensonge, par qui se perpétuent les fruits funestes de cette diffusion, la sainte Assemblée a décrété, sur les traces de saint Charles Borromée, l’institution dans chaque diocèse d’un Conseil, formé d’hommes éprouvés des deux clergés, qui aura pour mission de surveiller les erreurs, de voir s’il en est de nouvelles qui se g1issent et se répandent, et par quels artifices, et d’informer de tout l’évêque, afin qu’il prenne, après commune délibération, les mesures les plus propres à étouffer le mal dans son principe, et à empêcher qu’il ne se répande de plus en plus, pour la ruine des âmes, et, qui pis est, qu’il ne s’invétère et ne s’aggrave (Actes du Congrès des évêques de l’Ombrie, novembre 1840. Titre II, art. 6). Nous décrétons donc que dans chaque diocèse un Conseil de ce genre, qu’il Nous plaît de nommer Conseil de vigilance, soit institué sans retard. Les prêtres qui seront appelés à en faire partie seront choisis à peu près comme il a été dit à propos des censeurs. Ils se réuniront tous les deux mois, à jour fixe, sous la présidence de l’évêque. Sur les délibérations et les décisions, ils seront tenus au secret. Leur rôle sera le suivant. Ils surveilleront très attentivement et de très près tous les indices, toutes les traces de modernisme dans les publications, aussi bien que dans l’enseignement; ils prendront, pour en préserver le clergé et la jeunesse, des mesures prudentes, mais promptes et efficaces. Leur attention se fixera très particulièrement sur la nouveauté des mots et ils se souviendront, à ce sujet, de l’avertissement de Léon XIII: On ne peut approuver, dans les écrits des catholiques, un langage qui, s’inspirant d’un esprit de nouveauté condamnable, parait ridiculiser la piété des fidèles, et parle d’ordre nouveau de vie chrétienne, de nouvelles doctrines de l’Eglise, de nouveaux besoins de l’âme chrétienne, de nouvelle vocation sociale du clergé, de nouvelle humanité chrétienne, et d’autres choses du même genre (28). Qu’ils ne souffrent pas de ces choses-là dans les livres ni dans les cours des professeurs.
74. Ils surveilleront pareillement les ouvrages où l’on traite de pieuses traditions locales et de reliques. Ils ne permettront pas que ces questions soient agitées dans les journaux, ni dans les revues destinées à nourrir la piété, ni sur un ton de persiflage et où perce le dédain, ni par manière de sentences sans appel, surtout s’il s’agit, comme c’est l’ordinaire, d’une thèse qui ne passe pas les bornes de la probabilité et qui ne s’appuie guère que sur des idées préconçues.
75. Au sujet des reliques, voici ce qui est à tenir. Si les évêques, seuls compétents en la matière, acquièrent la certitude qu’une relique est supposée, celle-ci doit être retirée du culte. Si le document témoignant de l’authenticité d’une relique a péri dans quelque perturbation sociale ou de toute autre manière, cette relique ne devra être exposée à la vénération publique qu’après récognition faite avec soin par l’évêque. L’argument de prescription ou de présomption fondée ne vaudra que si le culte se recommande par l’antiquité selon le décret suivant porté en 1896 par la Sacrée Congrégation des Indulgences et Reliques: Les reliques anciennes doivent être maintenues en la vénération où elles ont été jusqu’ici, à moins que, dans un cas particulier, on ait des raisons certaines pour les tenir fausses et supposées. En ce qui regarde le jugement à porter sur les pieuses traditions, voici ce qu’il faut avoir sous les yeux: l’Eglise use d’une telle prudence en cette matière qu’elle ne permet point que l’on relate ces traditions dans des écrits publics, si ce n’est qu’on le fasse avec de grandes précautions et après insertion de la déclaration imposée par Urbain VIII; encore ne se porte-t-elle pas garante, même dans ce cas, de la vérité du fait; simplement elle n’empêche pas de croire des choses auxquelles les motifs de foi humaine ne font pas défaut. C’est ainsi qu’en a décrété, il y a trente ans, la Sacrée Congrégation des Rites (29): Ces apparitions ou révélations n’ont été ni approuvées ni condamnées par le Saint-Siège, qui a simplement permis qu’on les crût de loi purement humaine, sur les traditions qui les relatent, corroborées par des témoignages et des monuments dignes de foi.
Qui tient cette doctrine est en sécurité. Car le culte qui a pour objet quelqu’une de ces apparitions, en tant qu’il regarde le fait même, c’est-à-dire en tant qu’il est relatif, implique toujours comme condition la vérité du fait; en tant qu’absolu, il ne peut jamais s’appuyer que sur la vérité, attendu qu’il s’adresse à la personne même des saints que l’on veut honorer. Il faut en dire autant des reliques.
Nous recommandons enfin au Conseil de vigilance d’avoir l’oeil assidûment et diligemment ouvert sur les institutions sociales et sur tous les écrits qui traitent de questions sociales, pour voir s’il ne s’y glisse point du modernisme, et si tout y répond bien aux vues des Souverains Pontifes.
76. Et de peur que ces prescriptions ne viennent à tomber dans l’oubli, Nous voulons et ordonnons que tous les Ordinaires des diocèses, un an après la publication des présentes, et ensuite tous les trois ans, envoient au Saint-Siège une relation fidèle et corroborée, par le serment sur l’exécution de toutes les ordonnances contenues dans les présentes Lettres, de même que sur les doctrines qui ont cours dans le clergé, et surtout dans les Séminaires et autres Institutions catholiques, sans en excepter ceux qui sont exempts de la juridiction de l’Ordinaire. Nous faisons la même injonction aux Supérieurs généraux des Ordres religieux en ce qui regarde leurs sujets.
77. Voilà, Vénérables Frères, ce que Nous avons cru devoir vous dire pour le salut de tout croyant. Les adversaires de l’Eglise en abuseront sans doute pour reprendre la vieille calomnie qui la représente comme l’ennemie de la science et du progrès de l’humanité. Afin d’opposer une réponse encore inédite à cette accusation – que d’ailleurs l’histoire de la religion chrétienne avec ses éternels témoignages réduit à néant, – Nous avons conçu le dessein de seconder de tout Notre pouvoir la fondation d’une Institution particulière qui groupera les plus illustres représentants de la science parmi les catholiques et qui aura pour but de favoriser, avec la vérité catholique pour lumière et pour guide, le progrès de tout ce que l’on peut désigner sous le nom de science et d’érudition. Plaise à Dieu que Nous puissions réaliser ce dessein avec le concours de tous ceux qui ont l’amour sincère de l’Eglise de Jésus-Christ.
En attendant, Vénérables Frères, plein de confiance en votre zèle et en votre dévouement, Nous appelons de tout coeur sur vous l’abondance des lumières célestes, afin que, en face du danger qui menace les âmes, au milieu de cet universel débordement d’erreurs, vous voyiez où est le devoir et l’accomplissiez avec toute force et tout courage. Que la vertu de Jésus-Christ, auteur et consommateur de notre foi, soit avec vous. Que la Vierge Immaculée, destructrice de toutes les hérésies, vous secoure de sa prière. Nous, comme gage de Notre affection, comme arrhes de consolation divine parmi vos adversités, Nous vous accordons de tout coeur, ainsi qu’à votre clergé et à votre peuple, la bénédiction apostolique.
78. Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 8 septembre 1907, la 5e année de Notre Pontificat.
NOTES
(1) Act. XX, 30.
(2) Tit. I, 10.
(3) II Tim. III, 13.
(4) De Revel., can. I.
(5) Ibid., can. II.
(6) De Fide, can. III.
(7) De Revel., can. III.
(8) GRÉGOIRE XVI, Enc. Singulari Nos, VII k. Jul. 1834.
(9) Brev. ad Ep. Wratislav., 15 Jun. 1857.
(10) Ep. ad Magistros theol. Paris., non. Jul. 1223.
(11) Prop. 29 condamnée par Léon X. Bulle Exsurge Domine, 16 mai 1520: » Il Nous a été donné de pouvoir infirmer l’autorité des Conciles, de contredire librement à leurs actes, de Nous faire juge des lois qu’ils ont portées et d’affirmer avec assurance tout ce qui nous paraît vrai; que cela soit approuvé ou réprouvé par n’importe quel Concile. »
(12) Sess. VII, de Sacramentis in genere, can. 5.
(13) Prop. 2. La proposition qui établit que le pouvoir a été donné par Dieu à l’Eglise pour être communiqué aux pasteurs, qui sont ses ministres, pour le salut des âmes, ainsi comprise que le pouvoir de ministère et de gouvernement dérive de la communauté des fidèles aux pasteurs : hérétique.
Prop. 3. De plus, celle qui établit que le Pontife Romain est chef ministériel, ainsi expliquée que le Pontife Romain reçoit non pas du Christ, en la personne dut bienheureux Pierre, mais de l’Eglise, le pouvoir de ministère dont il est investi dans toute l’Eglise, comme successeur de Pierre, vrai Vicaire du Christ et Chef de toute l’Eglise : hérétique.
(14) Encycl. Qui pluribus, 9 Nov. 1846.
(15) Syllabus Prop. 5.
(16) Const. Dei Filius, cap. IV.
(17) Loc. cit.
(18) Ad Rom. I, 21-22.
(19) Conc. Vat., De revel., c. 2.
(20) Epist. XXVIII
(21) Ep. Encycl. Singulari Nos, 7 kal. Jul. 1834.
(22) Syllabus, prop. 13.
(23) Motu proprio. Ut mysticam. 14 Martii 1891.
(24) Léo XIII, Enc. AEterni Patris.
(25) Léo XIII, Litt. ap. In magna, 10 Déc. 1889.
(26) Alloc. 7 Martii 1880.
(27) Loc. cit.
(28) S. C. AA. EE. EE., 27 Jan. 1902.
(29) Decr. 2 Mai 1877.